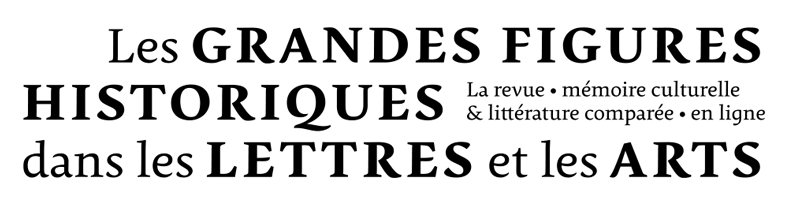Le correcteur possède le don remarquable de pouvoir se dédoubler…
José Saramago
La victoire de la démocratie au Portugal, en avril 1974, produit une immense transformation politique et sociale dont les répercussions sont évidentes dans le champ littéraire qui emprunte alors de nouvelles pratiques d’écriture, ouvertes à l’hétérogène, caractérisées par une indéniable liberté. Ce phénomène s’impose surtout à partir de 1980, lorsque le roman portugais se vivifie, grâce au travail d’un certain nombre d’écrivains qui interrogent les temps révolus pour ausculter, selon le paradigme postmoderne, les rapides mutations du présent, en associant la représentation des personnages illustres et la déconstruction ironique des événements historiques bien connus du lecteur. Leur « transcription de l’histoire » révèle souvent une inquiétude esthétique et un engagement éthique, que l’on peut identifier aussi dans une partie de la littérature européenne de la fin du XXe siècle1.
Dans le cas portugais, des écrivains tels que José Saramago, António Lobo Antunes, Mário Cláudio, Lídia Jorge, João de Melo et Mário de Carvalho, parmi beaucoup d’autres, introduisent dans leurs récits des procédés audacieux, destinés à tourner en dérision les figures du pouvoir habituellement célébrées dans l’historiographie officielle. De tous ces auteurs, José Saramago (1922-2010), prix Nobel de littérature en 1998, est sans doute celui qui va plus loin dans l’interprétation satirique du passé par le recours à la métafiction historiographique2 lui permettant de questionner les grands récits de légitimation qui, selon Jean-François Lyotard, régissent le pouvoir hégémonique des institutions3. Depuis Relevé de Terre (1980) jusqu’à Caïn (2009), son dernier roman, le grand écrivain portugais revisite les frontières du réel et de l’imaginaire pour bâtir une œuvre foisonnante, profondément engagée, qui adopte toujours une posture critique face à l’injustice, en affirmant avec vigueur la possibilité de dire « non » à toutes les formes d’oppression4. C’est justement ce « non » qui détermine, dans Histoire du siège de Lisbonne (1989)5, le nœud de l’intrigue élaborée autour de l’itinéraire de Raimundo Silva, un correcteur exemplaire, un peu maniaque, chargé de relire les épreuves d’un récit historique au titre éponyme, consacré à un épisode emblématique de la Reconquête chrétienne qui se déroule au XIIe siècle, impliquant la participation des croisés dans la prise de la future capitale portugaise sous domination musulmane.
L’existence monotone du correcteur est bercée par son travail méticuleux et par des habitudes assez anodines comme se teindre les cheveux en cachette, se mettre au balcon pour contempler le Tage et les murailles du château, fréquenter la crémerie du quartier et observer d’un « regard oblique » (p. 65) les femmes qui dévorent des gâteaux, ou encore flâner dans les rues de la vieille ville assimilée à un labyrinthe. Attaché à sa conscience professionnelle et profondément contrarié par l’incompétence de l’historien qui prétend raconter la vérité sur le siège de 1147, le correcteur finit par succomber à la tentation de transformer une phrase en y ajoutant un simple adverbe de négation, ce qui a pour conséquence immédiate de modifier le sens des événements. Convoqué treize jours plus tard par son éditeur, il assume sans broncher la falsification du texte original et rencontre, par la même occasion, une inconnue prénommée Maria Sara, qui n’est autre que sa nouvelle directrice dont il va tomber amoureux. Assez rapidement, cette femme séduisante, divorcée et sans enfants, lui propose d’écrire une version alternative de la même histoire, c’est-à-dire une uchronie, selon laquelle les croisés étrangers, en route vers la Terre Sainte, ont refusé leur aide aux Portugais lors de la prise de Lisbonne. Désireux de relever ce défi audacieux et vite assiégé par l’amour, le correcteur commence à inventer un monde possible où la conquête de Lisbonne est envisagée à partir de la bifurcation introduite par le « point de divergence »6 qui s’offre à l’exploration d’un espace médiéval, placé entre vérité et mensonge, capable de révéler l’envers du discours académique prétentieux, truffé d’incohérences et entièrement consacré aux vainqueurs. La démarche contrefactuelle entreprise par le protagoniste du roman permet à José Saramago d’insuffler au récit historique une nouvelle dynamique, fondée sur des enjeux critiques, esthétiques et éthiques qui interrogent la valeur de certains héros incontournables de la culture portugaise, tout en démolissant quelques versions de l’histoire conventionnelle.
La volupté créatrice
L’histoire et la fiction ont suscité dès le XIXe siècle plusieurs questionnements qui ont évolué au fil du temps pour imposer de nouvelles approches et animer, dans le dernier tiers du XXe siècle, un débat très riche autour des singularités de ces deux pratiques d’écriture, l’une fondée sur une méthodologie scientifique qui lui garantit sa véracité, l’autre, relevant de l’imaginaire, de la feintise et donc du faux. Ainsi, Pierre Nora considère que « l’histoire est le produit d’un lieu social dont elle émane » car il y a « une fabrique de l’histoire »7, tandis que Paul Veyne, Michel de Certeau et Paul Ricœur, parmi d’autres, avancent l’idée d’une convergence entre les deux domaines qui se fécondent mutuellement, sans oublier de montrer que le rapport à la vérité ou à la réalité varie selon l’angle à travers lequel il est envisagé. De leur côté, les critiques postmodernes, comme Hayden White8, postulent que la réalité ne peut être connue que par la médiation du langage et que toute forme de connaissance, y compris l’histoire, ne peut passer que par l’étude des discours. Sans aller plus loin dans l’analyse de cette question complexe qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, il nous importe de souligner que lorsque José Saramago fait paraître Histoire du siège de Lisbonne, en 1989, il s’inscrit pleinement dans le débat sur les frontières poreuses entre l’histoire et la fiction. Dans ce roman, l’écrivain mobilise habilement l’« artefact uchronique »9 pour raconter ce qui n’a pas eu lieu mais qui aurait pu effectivement se produire à l’aube de la fondation du Portugal, en faisant appel à la poétique du double dont la présence est fréquente dans l’ensemble de son œuvre10. Axée sur l’aventure d’un siège autant historique qu’amoureux, l’intrigue romanesque accorde une place considérable au regard d’un narrateur très critique à l’égard de l’historiographie figée qui sacralise les événements importants du passé national ainsi que les identités héroïques largement fantasmées11.
Dès le début du roman, les épreuves à corriger fonctionnent comme une sorte d’hypotexte, ou de texte premier, que Raimundo Silva examine dans le moindre détail, pour constater que le travail de l’historien condense non seulement « une répétition des incidents rebattus et mille fois relatés » (p. 40), mais aussi un certain nombre de contradictions et d’erreurs révélatrices d’un manque de rigueur inacceptable dans l’écriture de l’histoire. Agacé par un énoncé arrogant qui prétend transmettre la vérité historique, le correcteur y ajoute donc une négation, créant par conséquent ce que Charles Renouvier nomme un « point de scission »12, susceptible de déstabiliser les certitudes.
Sous la plume du correcteur, l’uchronie se présente comme un discours toujours en devenir qui résulte d’une lecture attentive et d’une appropriation parodique de nombreuses archives, aboutissant à l’élaboration d’un hypertexte13, ou d’un texte second, qui ne peut être que fictionnel14, modulé par le double désir de combler les lacunes de l’histoire et, en même temps, de répondre à l’attente de Maria Sara. Celle-ci provoque, sans le savoir, un changement profond dans le quotidien du vieux célibataire qui, grâce à cette aventure amoureuse et littéraire, va se transformer peu à peu en écrivain fictif et donner une nouvelle orientation à son existence suspendue entre passé et avenir. Si le « non » ajouté au récit historique ne modifie pas le cours de l’histoire portugaise, il va prendre une dimension ontologique, en bouleversant la vie routinière de son auteur qui, après la « falsification délibérée » (p. 61), prend quelques décisions importantes, comme cesser de se teindre les cheveux, adopter un comportement moins austère et s’ouvrir à l’aventure amoureuse.
Tenté par la correction du récit de l’historien, Raimundo Silva « a l’impression de se dédoubler » (p. 50) à partir d’un écart compris comme un mouvement de dérivation. L’étrangeté de ce geste de rébellion résulte d’une bataille récurrente, que le narrateur décrit d’abord comme un « combat entre l’ange et le démon » (p. 50), puis, quelques pages plus loin, comme un « combat entre un docteur Jekill et un monsieur Hyde […] entre la tentation du changement propre au mal et l’esprit conservateur du bien » (p. 89). Le motif du double se retrouve dans la structure même du roman qui juxtapose deux temporalités distinctes, le passé et le présent, dans une même géographie urbaine puisque le lieu où se déroule l’action décisive entre chrétiens et musulmans n’est autre que celui où habite le correcteur, dont l’appartement se trouve littéralement dans la rue du Miracle-de-Saint-Antoine, un nom que l’on dirait inventé de toute pièce, mais qui correspond en réalité à la topographie lisboète. Cette coïncidence produit un jeu de miroirs où se reflètent également deux histoires d’amour à la symétrie parfaite, celle de Raimundo et Maria Sara, et celle de Mogueime et Ouroana. Ces deux personnages d’origine populaire, nés de la plume uchronique du correcteur-auteur, sont décrits par celui-ci avec des mots très simples, au cours d’un dialogue avec sa directrice :
Lui est soldat, il a participé à la prise de Santarém, elle a été capturée en Galice pour servir de concubine à un croisé, Il y a donc une histoire d’amour, Si on peut l’appeler ainsi, Vous avez des doutes, C’est que je ne sais pas comment on s’aimait en ce temps-là ou disons que je suis peut-être capable d’imaginer le sentiment, mais je n’ai aucune idée et aucun renseignement sur la façon dont un homme et une femme du peuple l’exprimaient à cette époque, en l’occurrence la langue ne serait pas un obstacle, tous deux parlaient galicien, Inventer une histoire d’amour sans mots d’amour, je suppose que c’est déjà arrivé…15
On entrevoit ici le style auquel José Saramago a habitué son lecteur depuis Relevé de terre, son premier grand roman, paru en 1980, qui raconte l’épopée des paysans d’Alentejo au cours du XXe siècle16. En effet, c’est à partir de cet ouvrage que l’écrivain commence à écrire autrement17, inaugurant ainsi un véritable tournant dans sa pratique littéraire par le choix d’un usage particulier de la ponctuation et par l’accent mis sur l’oralité, la fusion des discours direct et indirect, et l’hybridité de la voix narrative18. Dans Histoire du siège de Lisbonne, ce style sous-tend une architecture bipolaire où la potentialité de l’imaginaire croise les nombreuses réflexions métatextuelles d’un narrateur très bavard dont la voix renvoie tantôt à un énonciateur omniscient qui donne accès à l’atelier de l’écrivain, tantôt aux mouvements du protagoniste dont l’écriture est retranscrite au fur et à mesure de son élaboration. Les mécanismes de cette feintise partagée invitent le lecteur à se glisser dans l’univers d’une double fiction qui se déroule autour d’un registre contrapuntique ; celui-ci rend à la fois la successivité, le décalage et la simultanéité d’une conquête que Raimundo Silva expérimente intensément dans les plis historiques du passé et dans les contours sentimentaux du présent.
Le dédoublement à caractère ludique est convoqué dès l’ouverture du roman par l’injonction suggérée dans l’épigraphe non signée19, empruntée par José Saramago à un Livre des Conseils inexistant, qui oriente le lecteur vers la dualité inscrite dans tout l’édifice romanesque. Ce paratexte fictif annonce déjà un programme qui va se définir entre le « oui » de l’incipit et le « non » à l’origine de l’uchronie, dans une opposition soulignée encore par le dialogue qui réunit, au premier chapitre, l’historien et le correcteur autour d’un signe typographique, le deleatur. Dans une certaine mesure, cette conversation renvoie au nœud du roman, c’est-à-dire à la réflexion polémique concernant l’écriture de l’histoire. Chacun des personnages y expose des points de vue différents et Raimundo Silva ose même affirmer que l’histoire se confond avec la littérature, se présentant à deux reprises comme un « voluptueux »20, ce qui n’est pas sans provoquer la surprise de son interlocuteur.
C’est en effet, un sentiment de volupté qui caractérise toute la démarche du correcteur que le narrateur va accompagner avec beaucoup d’attention, commentant les différentes étapes de la création uchronique, cadencée par les conditions météorologiques comme la présence et l’absence du brouillard et de la pluie, qui ponctuent les moments névralgiques du récit. On découvre d’abord la délectation du correcteur en train d’identifier un certain nombre d’anachronismes21 dans le texte de l’historien au « patriotisme fervent » (p. 41), puis le plaisir avec lequel il se met en quête des traces du passé, plongeant dans les archives entassées dans son bureau « comme une galaxie frémissante » (p. 27), et, enfin, le désir de raffinement qui caractérise son imagination fertile et sa reconfiguration de l’histoire, sans oublier, évidemment, la jouissance qu’il exprime à l’occasion des premières rencontres amoureuses dans son appartement, suscitant la méfiance de la femme de ménage toujours à l’affût du moindre changement dans la vie réglée de son patron. La volupté du correcteur se décline donc en plusieurs visages qui convergent vers un point central constitué par le déplacement de l’autorité narrative ; celle-ci se confronte à l’incertitude des faits lorsque l’uchronie croise ce que Paul Ricoeur nomme « la fascination du révolu »22. C’est bien par le biais de son délicieux « méfait » (p. 78) que Raimundo Silva retrouve l’ambivalence de l’opération historiographique, considérée par beaucoup de spécialistes comme une fiction verbale ou un artifice littéraire qui se rapproche du pouvoir politique dans sa gestion du passé. En somme, au cours de son travail d’écriture, le correcteur va découvrir que si l’histoire est avant tout un récit, elle est également une pratique d’énonciation liée à un pouvoir institutionnel et, par conséquent, comme l’observe Michel de Certeau, « Avant de savoir ce que l’histoire dit d’une société, il importe donc d’analyser comment elle y fonctionne »23.
La révision critique de l’histoire
Au moment de reprendre à son compte la révision de la conquête de Lisbonne, le correcteur manifeste des convictions identiques à celles de José Saramago, son alter ego, qui, à l’instar des historiens des Annales et de nombreux critiques littéraires, envisage le discours historique comme une construction éminemment subjective24. Cette position oriente le récit uchronique vers un choix qui repose sur une véritable entreprise de démolition de la figure prestigieuse du premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques, surnommé « Le Conquérant », fils de Thérèse de Léon et Henri de Bourgogne. La version officielle le présente comme un héros auréolé d’une mission sacrée et prédestiné depuis l’enfance à accomplir de nombreux faits illustres. Au fil des siècles, les historiens, aidés de quelques poètes dont Camoens, ont fait de ce monarque un valeureux chevalier et un guerrier invincible que le « miracle d’Ourique » s’est chargé de souligner, en lui accordant une dimension providentielle. Son portrait fait toutefois l’objet d’un certain nombre de controverses, selon une étude de l’historien José Mattoso, parue en 199225. C’est justement sur ces perspectives divergentes que se fonde le correcteur pour faire tomber de son piédestal l’image glorieuse du fondateur de la première dynastie portugaise.
Bien avant d’être l’objet de quelques vers du Chant III des Lusiades (1572), la célébration messianique de Dom Afonso Henriques apparaît déjà à la fin du XIVe siècle, chez des chroniqueurs qui sacralisent la fameuse bataille où il affronte cinq rois maures, en 1139, dans la plaine d’Alentejo, à Ourique, lors d’une incursion victorieuse des Chrétiens en terres musulmanes. Selon la légende, le soir de cette bataille, le Christ sur la Croix apparaît au futur monarque et lui demande de se battre contre les Infidèles, malgré l’infériorité numérique de ses troupes. Il lui promet la victoire et le trône du Portugal, et lui donne comme blason les cinq plaies de la Crucifixion. Sur ce point, les archives médiévales se montrent assez imprécises et même contradictoires, comme le constate Raimundo quand il se met à compulser attentivement la « prolifération des sources secondaires et tertiaires » (p. 123) pour composer son récit. Considéré comme l’un des mythes fondateurs du Portugal26, le « miracle d’Ourique », longtemps pris pour authentique, est mobilisé à chaque période de crise nationale, en particulier lorsque le pays perd son indépendance en 1580 et reste sous domination espagnole jusqu’en 1640. Cette légende ne sera contestée qu’au milieu du XIXe siècle par la « pincée escomptée de scepticisme moderne » (p. 143) du grand historien Alexandre Herculano (1810-1877), qui fait paraître en 1846 le premier volume de son Histoire du Portugal27.
L’événement miraculeux, qui a longtemps flatté les Portugais, est d’abord évoqué dans le deuxième chapitre du roman, donnant lieu aux commentaires du narrateur qui, après la description du réveil de la ville arabe par le muezzin, évoque « le très célèbre miracle d’Ourique » à travers une parodie de Camoens28, suivie d’une distanciation ironique à l’égard du sacré :
[…] lorsque le Christ apparut au roi portugais et que celui-ci lui cria, tandis que l’armée prostrée à terre priait, Aux infidèles, Seigneur, pas à moi, car moi je crois que vous pouvez le faire mais le Christ ne voulut pas apparaître aux Maures, et ce fut grande pitié, car au lieu de cette très cruelle bataille nous pourrions consigner aujourd’hui dans ces annales la conversion merveilleuse des cent cinquante mille barbares qui y perdirent finalement la vie, un scandaleux gaspillage d’âmes. C’est comme ça, on ne peut pas toujours tout éviter, nous ne manquons jamais de prodiguer à Dieu nos bons conseils, mais le destin a ses lois inflexibles, accompagnées souvent d’effets artistiques inattendus comme celui qui permit à Camoens de tirer parti du cri enflammé et d’en meubler tel quel deux vers immortels. Tant il est vrai que dans la nature rien ne se crée et rien ne se perd, tout est mis à profit.29
Dans cet extrait où résonne la voix du grand poète du XVIe siècle, le lecteur peut reconnaître aussi la présence de José Saramago et son habituelle critique à l’égard de la religion catholique30, à travers le recours à la métalepse, définie par Genette comme « le passage d’un « monde » à l’autre »31, impliquant une subversion qui remet en question « la frontière mouvante, mais sacrée entre deux mondes, celui où l’on raconte et celui que l’on raconte »32. En proposant une circulation entre divers niveaux narratifs, la métalepse organise également le récit dans la perspective d’une étroite articulation entre l’imagination et la réflexion, ce qui nous permet de considérer le roman comme une « fiction critique »33.
Si nous relisons attentivement l’extrait ci-dessus, nous pouvons encore constater que l’ironie dissimulée dans l’exagération de la plainte initiale du narrateur n’est qu’un moyen de déconstruire l’intention du message dont la tonalité relève évidemment de la logique carnavalesque. Le motif du double apparaît aussi dans la référence intertextuelle à Camoens, évoqué deux fois, d’abord à travers l’imitation de deux vers célèbres des Lusiades (« Aux Infidèles Seigneur !… »), puis dans la conclusion qui établit une relation entre le poète érudit et l’aphorisme, mettant sur le même plan deux types de discours fort différents. Ainsi, l’ambivalence, principe de clivage du texte, dédouble le langage grâce au jeu entrecroisé de la culture savante (le poème épique) et de la culture populaire véhiculée par le savoir traditionnel qui se multiplie dans les proverbes disséminés tout au long du roman. En effet, le narrateur a souvent recours à ces structures signifiantes, dont le contenu et la forme ne peuvent être dissociés. Par cette procédure, le citationnel recouvre une composante rhétorique qui correspond au domaine de l’intertextualité et une composante idéologique constitutive d’un univers doxographique assimilé à la voix du discours social ou à l’écho des savoirs traditionnels. Le montage des styles opposés, qui suggère la carnavalisation de la représentation, très fréquente chez José Saramago, dévoile une pratique selon laquelle l’écriture devient le lieu d’une confrontation capable de générer un processus critique afin de déconstruire, par le biais de cette autre forme de dédoublement qu’est l’ironie, les limites de l’historiographie conventionnelle ainsi que la substance des mythes nationalistes.
Raimundo Silva adopte clairement la posture ironique lorsqu’il s’attache à décrire le roi au double nom (Ibn Arrinque, pour les Maures), caractérisé à partir de quelques attributs négatifs, en particulier son aspect physique, son comportement et son langage. Pour dessiner le portrait royal, le correcteur s’inspire directement d’une source historique, la Chronique des cinq rois du Portugal34, qui lui permet d’affirmer que Dom Afonso Henriques présente à sa naissance des « jambes rabougries ou atrophiées » (p. 21). Le « petit infirme » (p. 44) sera néanmoins transformé avant l’âge adulte par une intervention miraculeuse de la Vierge Marie qui apparaît en songe à son précepteur, Dom Egas Moniz, et lui ordonne d’aller « creuser de ses propres mains » (p. 22) un temple abandonné à Carquere pour installer ensuite l’Infant sur l’autel afin de le guérir de sa malformation physique. Ces éléments reprennent exactement la source médiévale, qu’ils imitent dans le déroulement de l’action, mais le narrateur ne peut s’empêcher d’y ajouter son regard ironique lorsqu’il dénonce l’attitude du précepteur qui « donna l’ordre de creuser à d’autres, à des serfs probablement, étant donné que pareilles inégalités sociales existaient déjà en ce temps-là » (p. 22). À travers la reconstitution parodique du miracle de Carquere, le récit établit un dialogisme textuel avec sa source référentielle et s’en éloigne par une parole critique qui conforte une position délibérément axiologique. Celle-ci s’attache à redessiner la figure du double inscrite dans la parodie qui, d’après Linda Hutcheon, « est à la fois un « hommage » respectueux et un ironique « pied de nez » à la tradition »35. L’aspect ridicule du roi est encore accentué par ses manières à table, bien peu civilisées – il « mange avec ses doigts comme un sauvage » (p. 65) – et par son apparence repoussante – « le roi est cet homme barbu aux armes sales et qui sent la sueur » (p. 135) –, à tel point que la description efface les frontières entre le corps et le monde, suivant la logique carnavalesque bien définie par Bakhtine36.
Le langage utilisé par le roi est un autre motif destiné à le ridiculiser. Lorsqu’il s’exprime dans l’hypotexte, Dom Afonso Henriques utilise un discours confus et alambiqué qui épouse la version du croisé Osberno traduite du latin par le personnage de l’historien. Le correcteur y voit une « harangue compliquée » (p. 44), complètement absurde, qui l’amène à utiliser encore une fois la négation pour conclure que « Non, ce discours n’est pas l’œuvre d’un roi débutant, sans grande expérience diplomatique, il y a là le doigt, la main et la tête d’un ecclésiastique » (p. 46). Dans la réécriture de la même scène au sein de l’hypertexte, Raimundo invente un autre discours, se plaisant à caricaturer la « voix puissante » (p. 137) du monarque qui s’adresse aux croisés en termes trop familiers, pour leur promettre une récompense minime en échange de leur éventuelle collaboration dans la prise de Lisbonne :
Bien que vivant dans ce cul du monde, nous ici présents avons ouï de grandes louanges à votre sujet […] À vrai dire, ce qui nous arrangerait bien ce serait une assistance du genre gratuit, c’est-à-dire que vous resteriez ici le temps de nous prêter main forte, l’opération finie vous vous contenteriez d’une rémunération symbolique et vous continueriez votre chemin vers les Lieux saints où là, oui, vous seriez rétribués et sur-rétribués, tant en biens matériels, les Turcs ne pouvant se comparer à ces Maures sur le plan des richesses, qu’en biens spirituels qui pleuvent là-bas sur le croyant à peine met-il le pied à terre.37
Cette tentative de marchandage de la part de Dom Afonso Henriques explique évidemment le refus de collaboration des croisés, point de départ de l’uchronie qui gagne ici une remarquable dimension critique. En effet, dans cette scène, le correcteur laisse entrevoir l’opportunisme des chevaliers étrangers qui agissent au nom de la foi chrétienne mais dont l’intérêt principal est l’argent ; en même temps, il tourne en dérision l’attitude pingre du roi, incapable de cacher son orgueil, son ridicule sentiment de supériorité, ainsi que le messianisme providentialiste qui le caractérise dans les chroniques hagiographiques et que l’on peut lire dans cet extrait :
La vérité qui en toutes choses s’exprime par ma bouche m’oblige à dire que j’ai de bonnes raisons de penser que même si nous ne parvenons pas à un accord, nous serons capables de vaincre les Maures seuls et de prendre la ville, comme il y a à peine trois mois nous avons pris Santarém avec une échelle et une demi-douzaine d’hommes, après quoi, une fois l’armée entrée, toute la population fut passée au fil de l’épée […] et si je vous dit cela ce n’est pas que je méprise votre assistance mais pour que vous n’imaginiez pas que nous sommes sans force et sans courage, et je n’ai pas encore mentionné d’autres raisons plus probantes et qui sont que nous, Portugais, comptons sur l’aide de notre Seigneur Jésus-Christ, tais-toi, Afonso.38
Cette dernière expression, bien révélatrice de l’impétuosité du roi, montre à nouveau sa faiblesse et son incapacité à garder le silence sur les miracles célestes qui font toute sa gloire. En même temps, ce discours ne fait que souligner l’infériorité des Portugais, tout en critiquant la religion, trop impliquée dans les affaires guerrières à côté des élites qui, au fil de l’histoire, ont souvent développé la croyance d’appartenir à un peuple élu, chargé par la volonté divine de répandre la civilisation chrétienne dans le monde entier, justifiant ainsi l’existence de l’empire colonial, implicitement évoqué par le correcteur.
Tenté par une relecture critique du passé, le correcteur prend une grande liberté avec l’historiographie car, en imaginant un autre monde possible, il s’essaie à une dégradation des grands mythes et à une désacralisation de la figure du roi fondateur, selon une perspective qui problématise la vérité historique toujours soumise aux relations de pouvoir39. Mais en abolissant la distance épique du récit historique traditionnel, qui permet d’éliminer l’altérité de l’événement, le correcteur manifeste aussi la volonté de rendre justice à des personnages exclus de l’histoire, en particulier les subalternes toujours silencieux dans les registres officiels.
La voix des grands oubliés de l’histoire
Si l’uchronie aime les grands hommes, comme l’affirme Éric Henriet40, nous pouvons constater que Raimundo Silva déroge à cette observation, car son récit démystifie soigneusement la figure du roi Dom Afonso Henriques, indissociable de la représentation théologique du destin portugais. Toutefois, le renversement de l’image sacrée du monarque trouve un contrepoint dynamique dans la valorisation de deux types de personnages qui occupent une place importante dans le récit, d’une part, les Musulmans dont le défaut principal est, selon le narrateur, d’appartenir à une religion différente et, d’autre part, les soldats chrétiens, définis par leur attitude rebelle, associée à une certaine conscience politique.
À côté de l’attention accordée aux personnages subalternes, un autre aspect intéressant du roman de José Saramago concerne le télescopage des temporalités qui parfois s’enchevêtrent pour confondre le réel et l’imaginaire, comme lorsque Raimundo croit distinguer, dans la crémerie de son quartier, la présence des Maures qui « entonnent en chœur, Nous vaincrons, nous vaincrons » (p. 67). Le passé et le présent se rejoignent ici dans le « non-temps » inauguré par l’uchronie pour créer une conscience caléidoscopique et faire advenir un regard critique afin d’atteindre à une vérité qui se dérobe toujours. Un peu plus loin, au moment où la ville est assiégée par le roi portugais, l’imagination du correcteur s’attarde un moment sur la réaction des Maures paniqués, assaillis par la faim, qui cherchent « dans un baptême chrétien précipité la damnation de leur âme musulmane » (p. 337-338). Malgré cette tentative de passer dans le camp de l’ennemi, ils ne trouvent en réponse que « la fureur et la rage démente » des soldats, comme le souligne le narrateur qui insiste sur la violence du combat, condensée dans une énumération cruelle : « ce fut une boucherie de langues, de nez et d’oreilles coupées » (p. 338).
Raimundo Silva est particulièrement attaché à la figure du muezzin aveugle qui appelle à la prière du matin et peuple une rêverie soigneusement décrite au début du deuxième chapitre. L’auteur de cette description n’est pas l’historien, mais il s’agit, selon le narrateur, « de vagues pensées qui ont traversé la tête du correcteur pendant qu’il lisait et corrigeait ce qui était passé inaperçu par mégarde dans les premières et les deuxièmes épreuves » (p. 23). Après cette précision, le narrateur attire malicieusement l’attention du lecteur sur certains détails, en ajoutant une série de considérations autoréflexives qui le conduisent à corriger lui aussi, comme par mimétisme, les lacunes du correcteur qui, à son avis, a trop d’imagination et oublie d’évoquer au cours de sa rêverie des éléments aussi importants que les ablutions rituelles du muezzin, manifestant par cette omission une « légèreté impardonnable » (p. 25). Le muezzin est à nouveau évoqué à la fin du roman, à l’occasion de la bataille entre Maures et Chrétiens, avant d’être égorgé par un soldat qui signe par ce geste la victoire des Portugais.
Parallèlement à la référence à l’ennemi musulman, Raimundo Silva accorde une attention particulière à quelques personnages marginaux qui participent au siège de Lisbonne, en particulier Mogueime, le soldat dont le nom apparaît déjà dans la très ancienne Chronique des Cinq Rois du Portugal, que le correcteur utilise pour décrire le miracle de Carquere, comme nous l’avons déjà vu. Parmi les sources qui enrichissent la bibliothèque de Raimundo, il y a encore deux autres ouvrages qui nourrissent le dialogue intertextuel, « l’instructive Chronique de Dom Afonso Henriques » (p. 188), de Frei António Brandão, datant du XVIIe siècle, et la fameuse Histoire du Portugal, publiée entre 1846 et 1853 par Alexandre Herculano, dont le scepticisme est aisément adopté par le correcteur. Ces sources font encore l’objet d’une appropriation parodique afin de consolider la vraisemblance des personnages créés de toute pièce par l’uchronie.
Dans le récit de Raimundo, le soldat Mogueime, malgré son statut marginal, occupe une place centrale lors de la prise de Santarém, à côté de Mem Ramires, le guerrier qui accompagne le roi dans l’expansion du royaume. Au lieu d’accorder la parole à ce grand héros de l’histoire portugaise, le correcteur fait le choix délibéré de mettre en scène le soldat qui transmet avec efficacité son témoignage sur l’aventure vécue à Santarém, juste avant le siège de Lisbonne :
Mem Ramires m’a appelé parce que j’étais le plus grand et il m’a ordonné de grimper sur ses épaules, j’ai accroché l’échelle en haut, ensuite il est monté, et moi avec lui, et un autre avec moi, et pendant que nous attendions que les autres montent, les gardes se sont réveillés et l’un d’eux a demandé, Menfu, ce qui veut dire, Qui va là, et Mem Ramires, qui parle l’arabe comme un Maure, a dit que nous faisions partie de la ronde et que nous avions reçu l’ordre de revenir en arrière, et comme le Maure était descendu de la tour il lui a coupé la tête, que nous avons lancée dehors […] et c’est ainsi que Santarém a été conquise, j’ai participé à sa prise, avec d’autres qui sont ici à côté de moi.41
À travers ces mots très simples, qui ne respectent pas la hiérarchie militaire, Mogueime se met en valeur, tout en faisant entendre la langue de l’ennemi incapable de résister à la ruse portugaise. Il déplace aussi le regard du lecteur vers les véritables héros de ce haut fait de la Reconquête, réduit à la banalité d’une situation profondément cocasse. À propos de cet événement, les sources historiques proposent des versions différentes, ce qui conduit le correcteur à douter de la parole du soldat. En comparant ses archives, Raimundo constate que la Chronique de Dom Afonso Henriques indique que Mogueime est effectivement monté sur les épaules de Mem Ramires, tandis que la Chronique des cinq rois du Portugal soutient exactement le contraire. Face à cette divergence, le correcteur suit diverses pistes et finit par conclure que « Mogueime est indiscutablement un menteur » (p. 190).
Dans la version du soldat, on peut remarquer aussi une valorisation du collectif, qui fait écho à l’épisode de la bataille finale, lorsque le récit énumère un certain nombre de noms de guerriers, rappelant la scène d’un autre roman de José Saramago42, dans une démarche qui prétend de toute évidence faire sortir de l’anonymat les grands oubliés de l’histoire:
Avec eux, étendus au fond de la barque les uns sur les autres, comprimés par l’étroitesse de l’espace, iront aussi Diogo, Gonçalo, Fernão, Martinho, Mendo, Garcia, Lourenço, Pêro, Sancho, Álvaro, Moço, Godinho, Fuas, Arnaldo, Soeiro, et tous ceux qui manquent encore pour que le compte y soit, certains portent le même nom mais nous ne les mentionnons pas, afin que personne ne puisse protester. […] Un nom n’est rien, nous pouvons en trouver la preuve chez Allah qui malgré ses quatre-vingt-dix-neuf noms n’a réussi à être que Dieu.43
Par la valorisation de l’effort collectif au détriment de l’action individuelle, le récit uchronique s’attache à détrôner quelques paradigmes de l’orgueil national portugais, en montrant que, à l’instar de Santarém, la conquête de Lisbonne, attribuée généralement à la bravoure de Dom Afonso Henriques, ne résulte que de l’implication courageuse des troupes issues du petit peuple qui, avant de combattre, se révoltent de façon inattendue contre le pouvoir royal, afin d’exiger une augmentation de leur solde. Ainsi, lorsque Lisbonne est déjà assiégée depuis plusieurs mois et que le roi connaît de sérieux problèmes financiers, les soldats désignent trois mandataires, chargés de transmettre leurs exigences à Mem Ramires. L’un d’eux est évidemment Mogueime qui, conscient des « justes intérêts personnels et collectifs » (p. 334), s’adresse au capitaine en ces termes :
[…] la question c’est que nous voulons être payés comme les étrangers, et voyez jusqu’où va notre bon sens, mon capitaine, car nous ne venons pas demander que des étrangers soient payés au même tarif que nous. Les deux autres mandataires hochèrent la tête en silence, pareille éloquence n’avait pas besoin d’être répétée, et l’entrevue prit fin.44
Mem Ramires essaie de tempérer les ardeurs de ses hommes soudain épris de justice salariale, mais malgré ses exhortations patriotiques, ses menaces et son chantage affectif, il n’arrive pas à calmer la rébellion qui finit par arriver aux oreilles du roi. Une fois en présence du monarque, Mogueime et ses compagnons se montrent déterminés et presque arrogants lorsqu’ils défendent leurs droits :
Quand les cinq hommes entrèrent dans la tente, le roi, la mine sombre, ses bras puissants croisés sur sa poitrine, les prit violemment à partie. Je ne sais si je vais ordonner qu’on coupe les pieds qui vous ont amenés, ou la tête d’où sortiront vos paroles impudentes, si vous osez ouvrir la bouche, et ses yeux étincelants s’étaient posés sur le plus grand des délégués qui était Mogueime, on l’a deviné. Or ce fut une belle chose à voir et probablement possible seulement en ces temps innocents, mais la figure de Mogueime se haussa encore davantage et sa voix claire fusa, Si Votre Altesse nous fait couper la tête et les pieds, ce sera toute votre armée qui se retrouvera sans pieds ni tête. Dom Afonso Henriques ne pouvait en croire ses oreilles, un enrôlé de l’infanterie populaire qui prétendait revendiquer pour sa vile corporation des mérites qui devraient être la seule prérogative de la classe noble de la cavalerie, car c’est elle la vraie armée, la piétaille ne servant qu’à grossir les effectifs sur le champ de bataille ou à former des cordons lors des sièges, comme c’est le cas en ce moment.45
Présenté d’abord comme un personnage autoritaire, tant par l’attitude que par l’expression, le roi se montre rapidement désarçonné par l’audace du représentant des soldats. Dans cet extrait, l’échange entre le monarque et Mogueime fait rapidement place au commentaire du narrateur qui devient explicite, introduisant dans le récit une réflexion admirative suivie d’un modalisateur qui implique une forme de jugement positif. Trouvant « la réponse du délégué spirituelle » (p. 335), le roi finit par réagir avec humour et accepte d’écouter les nouvelles revendications de Mogueime :
Vous le savez déjà, sire, nous voulons avoir une juste part du pillage, à l’égal de tous ceux qui sont venus ici donner leur sang, lequel, une fois répandu, a la même couleur que celui des croisés étrangers, de même quand la mort nous fauche et que nous pourrissons, notre corps pue comme le leur, Et si je répondais non, vous ne prendrez pas part à la mise à sac, Alors, sire, vous vous emparerez de la ville avec les croisés qui vous restent parmi ceux qui ne sont pas partis, C’est une rébellion que vous déclarez là, Sire, ne le prenez pas ainsi, je vous le conjure, car s’il est vrai qu’il y a une certaine idée de profit dans notre esprit, dites-vous aussi que c’est un acte de justice que de payer également ce qui est égal.46
Nous pouvons observer que, dans ce dialogue, José Saramago fait de nouveau un usage très personnel de la virgule et de la majuscule pour donner la primauté à la valeur mélodique de la phrase dont la tonalité se rapproche de l’oralité, nous donnant à entendre le hors-champ où évoluent les personnages populaires, capables de parler d’égal à égal avec le représentant du pouvoir, ce qui implique une fois de plus la subversion des normes hiérarchiques. Ces exemples nous montrent que le correcteur se révèle très accessible à l’altérité, faisant émerger les comportements et les voix étouffées de tous ceux qui n’ont jamais pu s’exprimer dans les pages écrites par les historiens officiels. Cette perspective nous permet de constater que José Saramago semble avoir intériorisé la célèbre observation de Walter Benjamin, selon laquelle l’histoire devrait être écrite selon le point de vue des vaincus, contre la tradition conformiste de l’historicisme qui révèle toujours une grande empathie avec les vainqueurs47.
Dans Histoire du siège de Lisbonne, le narrateur omniscient, alter ego de José Saramago lui-même, crée un double pacte de lecture, d’abord avec le lecteur, puis entre Raimundo et Maria Sara, la directrice de la maison d’édition visiblement intéressée par l’uchronie. Dans les deux cas, le romancier situe l’aventure de ses personnages sur le plan de la métafiction. Celle-ci devient une dominante formelle et thématique de la narration dont la finalité essentielle est de questionner l’écriture de l’histoire, montrant aussi bien ses limites que ses immenses possibilités. Considérée comme une pratique majeure de la littérature postmoderne, la métafiction historiographique, nourrie par le soupçon, se caractérise par une intention réflexive, chargée de remettre en cause les héros, la légitimité des grands récits, notamment celui de l’histoire en tant que pensée totalisante, tout en rappelant l’arbitraire de la distinction entre discours littéraire et discours historiographique dans la représentation du réel. Scandé par de nombreuses références intertextuelles (citations, allusions, pastiches, etc.), le roman mobilise aussi des légendes et des rêves transmis par les archives afin de les déconstruire ensuite, mais il fait également appel à des renvois intratextuels (évocation d’autres œuvres de l’auteur48) et à de nombreuses digressions qui ralentissent le rythme de l’action et impliquent, comme nous avons vu, le recours à des métalepses à teneur ludique, argumentative ou évaluative, produisant toujours une « circulation paradoxale entre divers niveaux narratifs »49. Il arrive parfois que le narrateur exprime une autoréflexivité aboutissant à une conscience explicite du déphasage des niveaux de la représentation, comme dans ce passage :
Certains auteurs […] ont horreur de l’évidence qui n’est pas toujours linéaire et explicite la relation entre ce que nous appelons cause et ce que, parce que cela intervient ensuite, nous appelons effet. […] Allant plus loin, avec une audace téméraire, les dits auteurs soutiennent que toutes les causes aujourd’hui visibles et reconnaissables ont déjà produit leurs effets et que nous n’avons qu’à attendre que ceux-ci se manifestent […] Pour nous exprimer maintenant comme l’homme de la rue, et avant que de tels raisonnements abstrus ne nous mènent à des problèmes plus ardus, tels que la preuve par la contingence du monde de Leibniz ou la preuve cosmologique de Kant, et qui nous conduirait tout droit à demander à Dieu s’il existe réellement ou s’il nous a bernés avec des concepts fumeux indignes d’un être suprême qui devrait tout faire et tout dire très clairement […] Cette conclusion, aussi peu concluante que providentielle, nous permet par un habile changement de plan narratif de revenir au correcteur Raimundo Silva à l’instant même où il est en train de commettre un acte dont nous n’avons pu pénétrer les motifs, occupés que nous étions par un solide examen général des causes et des effets, interrompu, heureusement, au moment où il menaçait de glisser vers d’ontologiques et paralysantes angoisses.50
Par-delà la question de Dieu, si fréquente sous la plume de José Saramago, ces réflexions exhibent encore une fois la conscience de l’auteur-narrateur sur les artefacts déployés au fil de son roman et qui conduisent le lecteur vers une autre réalité, celle du récit uchronique. Si les intrusions du narrateur cherchent à combler les vides ou les lacunes de l’histoire, elles multiplient aussi les foyers de focalisation, provoquant un brouillage des niveaux narratifs qui renvoient au statut spéculaire du récit. En fait, le dédoublement est constamment en jeu dans Histoire du siège de Lisbonne où les deux récits enchevêtrés impliquent, d’une part, la lecture globale du roman comme simple fiction et, d’autre part, l’uchronie en train de s’écrire à partir du récit de l’historien, prétexte que le romancier portugais utilise pour redéfinir le débat qui agite les intellectuels autour des rapports ambigus entre l’histoire et la fiction.
Remarques conclusives
Comme nous avons pu le constater, dans Histoire du siège de Lisbonne, l’uchronie ouvre une brèche dans le statut ordinaire du roman, autorisant les extrapolations les plus inattendues dans un cadre fictionnel bien délimité. Elle se révèle foncièrement créatrice, tout en dévoilant une double dimension esthétique et éthique51, notamment lorsque l’autorité énonciative interrompt la narration pour introduire des propos axiologiques qui produisent ce que Vincent Jouve nomme un « effet-valeur », constitué par une série d’éléments « permettant de repérer, derrière l’œuvre, une intention dont le lecteur est la cible »52. Sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que José Saramago propose, à l’intérieur de son roman, une forme d’hospitalité poétique particulièrement intéressante consistant à accueillir en filigrane deux récits différents, celui de l’historien, objet de la méfiance du correcteur, et le livre à venir que celui-ci se met à écrire pour relever le défi de la femme aimée et procéder à une révision de l’autorité historiographique. C’est dans ce rapport essentiel à l’ouverture que le romancier accueille également le lecteur, l’invitant à arpenter l’univers des possibles afin de déchiffrer la portée de la bifurcation que le protagoniste du roman manie avec habileté pour faire oublier la présence du mensonge qui est l’essence même de tout récit. Dans cette perspective, nous pouvons considérer que la « correction » du texte de l’historien à propos du siège de Lisbonne, source du travail de Raimundo Silva, devient un geste d’engagement qui « ouvre la sphère de l’éthos »53 et affirme une orientation idéologique bien assumée dans les stratégies narratives qui organisent la contestation, la dérision et la démystification des personnages illustres de l’histoire portugaise pour mettre plutôt en valeur les figures subalternes.
Parfaitement conscient de son scepticisme par rapport aux traces de l’aventure collective, José Saramago rejoint par cette position un certain nombre d’écrivains qui développent volontiers l’idée d’une responsabilité à l’égard de l’écriture, qui est aussi une « responsabilité pour autrui, pour tout lecteur confronté à l’énonciation d’une historicité à laquelle il appartient lui-même »54. Sur cette question, sa posture est en tout point conforme à ses déclarations publiques. Dans un entretien accordé, en 1990, à un journaliste portugais, le romancier affirme que l’historien est quelqu’un qui choisit les faits et se rapproche indéniablement de la pratique littéraire. Sans jamais prononcer le terme d’uchronie, il ajoute que l’écrivain, à la différence de l’historien, a toujours la possibilité de remplacer le passé par ce qui aurait pu exister, en considérant que cette « correction » correspond en somme à une « lecture critique » de l’histoire, semblable à une opération capable d’introduire « une instabilité, une vibration » dans le roman55. Histoire du siège de Lisbonne illustre sans aucun doute cet engagement inséparable d’une forme narrative conçue comme une pratique du dédoublement qui mobilise la tentation uchronique pour interroger avec brio les pouvoirs séducteurs de la fiction.