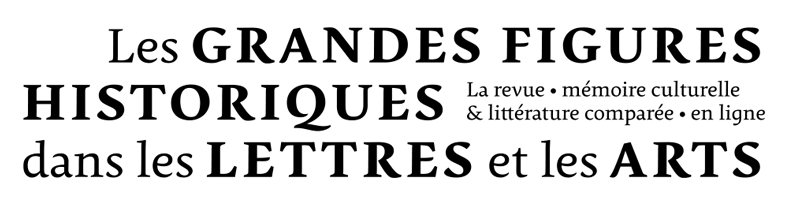L’immense succès que Scott a connu de son vivant l’a incité à répondre à la curiosité du public pour les vies des hommes et des femmes célèbres et plus particulièrement pour les écrivains. De la même façon qu’il a publié, en 1808, une vie de Dryden (Life of Dryden), et accompagné les romans édités dans Ballantyne’s Novelist Library de notices biographiques et critiques de 1821 à 1824, il a réédité à partir de 1827 sa propre œuvre poétique avec des notices biographiques écrites par ses soins. Dans le Magnum Opus, soit la grande réédition de ses romans jusque-là publiés anonymement, ceux-ci ont été précédés de notices qui expliquaient quelles étaient les origines et les sources de son inspiration1. Malgré les années d’anonymat qui ont entouré à la fois sa production romanesque et tout un ensemble de textes divers qu’il a édités et qu’il est parfois difficile d’évaluer2, Walter Scott s’est montré conscient du potentiel littéraire, mais aussi commercial, de ce type d’écrits où il s’agit de dévoiler l’homme derrière l’écrivain, afin de faire comprendre comment le mécanisme de la création s’est mis en place et accessoirement faire racheter ses œuvres en les recontextualisant.
Cette prise de conscience du pouvoir que la biographie ou l’autobiographie d’écrivains exerce s’est faite en plusieurs étapes, au gré des succès et des infortunes de l’auteur. Dans le mémoire qu’il a commencé à composer à Ashestiel en 1808, au plus fort de son succès poétique mais aussi à un moment où il a la sensation que la poésie nuit à son avancement professionnel3, il compare ironiquement son entreprise à un acte de dissection auquel il pourrait accepter de se soumettre, si cela devait aider la science et permettre de soigner des maladies. Ce sont les affections morales ou les idiosyncrasies d’auteur qu’il s’agirait de rechercher en l’occurrence, à l’instar de Burns, Chatterton ou Richard Savage4, à ceci près que l’auteur ne s’en reconnaît pas : au moment où il semble se résoudre à se mettre à nu, c’est pour aussitôt proclamer sa normalité, l’uniformité de ses habitudes et de son caractère. Il rompt même avec la figure d’auteur puisque l’écriture n’aurait eu que peu d’effets sur sa personnalité, car elle se serait constituée avant qu’il ne se soit engagé sur la scène littéraire, ce qu’il démontre en arrêtant son récit avant que sa carrière d’écrivain ne commence. Voilà donc les raisons principales de cette autobiographie qui sont sapées. Toutefois, dans un geste très scottien, il considère que, puisque, malgré tout, son public doit être satisfait, il se plie à l’exercice, estimant qu’il est le mieux placé pour informer le public, au-delà de sa mort et de sa postérité éventuelle, qui a donc été envisagée relativement tôt.
Ce récit, amorcé en 1808, s’est poursuivi en 1809-10, avant d’être repris au moment où les projets des rééditions de ses œuvres se cristallisent en 1826, en parallèle avec les différentes œuvres qu’il a publiées pour rembourser ses dettes après sa faillite et celle de son éditeur Ballantyne. À la différence des préfaces à caractère biographique qu’il a ajoutées à ses œuvres romanesques, son autobiographie n’a pas été publiée de son vivant. Le mémoire d’Ashestiel ouvre la biographie que son gendre John Gibson Lockhart a écrite en guise d’hommage après sa mort. Il est présenté comme un document de choix, au même titre que les extraits de lettres ou du journal intime de Scott qu’il insère également dans son propre texte. Nous ne reviendrons pas sur le travail éditorial que Lockhart a fait subir au mémoire (normalisation orthographique, ponctuation, mise en note des ajouts de 1826, précisions de dates) et qui ont été parfaitement expliquées par David Hewitt5. Mais la stratification du texte en plusieurs époques et sa recontextualisation à un moment où le succès littéraire est moins au rendez-vous, où le succès financier s’est avéré un mirage, et où, pour finir, l’auteur est mort, font que le vocabulaire de la Fortune et du hasard (chance) qui innerve ce texte donne lieu à plusieurs réinterprétations, qu’il convient d’étudier ici. Dans le contexte de 1808, le mémoire se lit à la lumière d’un succès poétique insolent qui a permis à l’auteur de s’enrichir et de se faire connaître internationalement. En 1826, mais surtout dans le cadre des sept volumes qui ont été publiés de 1837 à 1838, The Life of Walter Scott, l’itinéraire de l’auteur prend la dimension d’une tragédie naturelle, pour reprendre les mots de Hewitt à propos du journal intime de l’écrivain6. En quelques mois seulement, la roue de la Fortune a tourné : Scott a perdu sa femme, a connu la faillite et l’humiliation, et a dû se résoudre à devenir une sorte de forçat des lettres afin de payer ses dettes et libérer ses enfants d’un héritage encombrant. On comprend dès lors pourquoi il faut comprendre la fortune dans sa double acception financière et morale, même si l’auteur cherche à réduire la part de la première, peu honorable, pour privilégier la seconde, plus conforme à son ethos.
La présente étude s’appuiera sur les préfaces d’inspiration biographique et littéraire que Scott a ajoutées à ses œuvres poétiques, sur le mémoire d’Ashestiel tel qu’il apparaît dans la biographie de Lockhart et dans l’édition qu’en fait David Hewitt, enfin sur la version abrégée de La Vie de Walter Scott qui a été condensée par Lockhart lui-même en 1848. Nous montrerons comment Scott présente son existence comme le fruit de hasards et la poésie comme fruit de rencontres. Hésitant entre, d’un côté, le modèle noble wordsworthien de l’opportunité et de l’amitié poétiques, et, de l’autre, la représentation d’une sociabilité plus prosaïque de notable, Scott et Lockhart construisent, à la fois, la figure d’un auteur à succès soucieux d’une réussite matérielle qui lui ouvre les portes de la meilleure société et celle d’un homme qui peine à endosser cette forme de reconnaissance sociale. Il en résulte une analyse des comportements qui, face à la veine et à la déveine, interroge le stoïcisme moral de Walter Scott.
Hasard et rencontres : entre empirisme, légèreté et réflexion poétique
Que ce soit pour sa propre existence ou pour celles de toutes les figures fugitives qu’il fait apparaître dans ses mémoires, elles sont dominées par la contingence et le hasard qui les font basculer d’un côté ou de l’autre. Scott fait comprendre au lecteur la fragilité des itinéraires individuels qui tiennent à si peu de choses. Les exemples de ses proches, en particulier, sont donnés au lecteur, non seulement pour qu’il s’imprègne de l’ambiance familiale mais aussi pour qu’il perçoive ces courts récits de vie comme des contrepoints au parcours si singulier de l’auteur. Cet effet est particulièrement marqué lorsque Scott dépeint l’existence de sa sœur défunte, morte à 31 ans, accentuant même en 1826 l’effet des malheurs qui l’ont détruite :
I had an only sister, Anne Scott, who seemed to be from her cradle the butt of mischance to shoot arrows at. Her childhood was marked by perilous escapes from the most extraordinary accidents. Among others I remember an iron-railed door leading into the area in the centre of George’s Square being closed by the wind while her fingers were betwixt the hasp and staple. Her hand was thus locked in and must have been smashed to pieces, had not the bones of her fingers been remarkably slight and thin. As it was, her hand was cruelly mangled. On another occasion she was nearly drowned in a pond or old quarry-hole in what was then Brown’s Park, on the south side of the square. But the most unfortunate accident, and which, though it happened while she was only six years old, proved the remote cause of her death, was her cap accidentally taking fire. The child was alone in her room and before assistance could be obtained her head was dreadfully scorched. After a lingering and dangerous illness, she recovered, but never to enjoy perfect health. The slightest cold occasioned swellings in her face, and other indications of a delicate constitution. At length, in 1801 poor Anne was taken ill and died after a very short interval.7
Contrairement à sa pratique ordinaire, Lockhart n’a pas mis le deuxième accident qui a été ajouté tardivement au récit par l’auteur en note8, conservant l’effet d’une accumulation désastreuse d’accidents qui font d’Anne comme l’avers du fortuné Scott et la victime d’une Malchance personnifiée et particulièrement vindicative. Les autres enfants survivants de sa nombreuse fratrie sont aussi qualifiés d’infortunés, en partie en raison de leur caractère singulier (peculiar9). De tous, c’est le benjamin Daniel qui est considéré comme le plus malheureux de tous (last and most unfortunate, unhappy combination, unsuccessful attempts)10. De ce point de vue, sa fratrie rehausse par contraste les heureuses circonstances qui ont fait de Scott un homme reconnu et qui lui ont permis de se distinguer.
La bonne fortune de l’écrivain s’affiche néanmoins de façon paradoxale. Il est un enfant éclatant de santé, mais il a failli mourir en raison d’une nourrice atteinte de tuberculose. Plus tard, il a connu une fièvre, probablement la poliomyélite, qui, du jour au lendemain, a changé un enfant de 18 mois vigoureux et mobile en un enfant infirme qui a dû se battre pour retrouver un certain usage de sa jambe. Enfin, Scott nous donne, dans la foulée, une troisième expérience où il frôle la mort de près : une autre servante qui l’accompagnait chez ses grands-parents à Sandy Knowe a exprimé son désir de l’égorger à coups de ciseaux avant qu’elle ne soit renvoyée et qu’elle ne devienne folle11. Cette dernière anecdote a été signalée par Hewitt comme un autre ajout de 1826 qui, en raison de la nature très symbolique du chiffre trois, confère un tour très romanesque à son récit de jeunesse. D’un côté, Scott s’affirme comme celui qui a réchappé de ces coups répétés de la Fortune ; de l’autre, il fait valoir l’extrême fragilité des existences, la sienne, mais aussi celle des autres, toutes soumises aux vicissitudes les plus surprenantes. Il s’en est fallu donc de très peu pour que le jeune Walter ne suive le destin de ses frères et sœurs aînés qui sont morts en bas âge et qu’il n’a pas pu connaître. Le lecteur ne peut être que marqué par la légèreté avec laquelle l’auteur évoque ses propres malheurs, comme si celui-ci lui faisait des clins d’œil et lui disait : « j’aurais pu ne pas être là, j’aurais pu prendre un autre chemin, il n’y a pas de certitude dans l’existence », d’où l’évocation d’un autre double potentiel, son frère aîné Robert qui montrait lui aussi un talent littéraire et qui avait un talent militaire que Scott ne pouvait manquer de lui envier. L’Histoire (la fin des guerres américaines), puis le climat des Indes où il s’était rendu pour exercer son métier d’armes, ont mis un terme à ses ambitions et Robert est mort avant que ses potentialités ne puissent s’exprimer pleinement. C’est pour Scott dans l’ordre des choses, il ne s’y attarde pas et une micro-histoire chasse l’autre.
Marqué par l’empirisme de son temps, Scott suppose que l’individu se construit par les circonstances extérieures et par l’environnement qui produisent des sensations, nourrissent l’imagination et créent des pensées. Certes, le caractère et le tempérament influencent l’individu dans la manière dont il se saisit des événements. Aussi l’écrivain développe-t-il un rapport très moral face au hasard des circonstances, nous y reviendrons. Les différentes expériences que l’individu peut subir sont envisagées comme autant d’occasions à saisir. Sa sœur ne s’est jamais remise, non seulement à cause de la violence de ce qu’elle avait subi, mais aussi parce qu’elle n’a peut-être pas réagi au mieux. En revanche, Scott associe sa propre expérience traumatique au fait que, en raison de sa maladie, il ait pu bénéficier d’une éducation à la campagne, chez ses grands-parents, à la grande liberté de lecture qui s’en est suivi et surtout à la connaissance intime du folklore et des paysages des Borders qu’il a retirée de ce séjour. En somme, à la différence de l’expérience malheureuse que sa sœur a connue, l’accident est devenu une donnée positive parce qu’elle lui a permis d’échapper pour un temps au contrôle d’une famille austère, plutôt hostile à la littérature d’agrément, et de développer son imagination. La maladie a contribué à faire de lui un écrivain, alors que Scott aurait initialement préféré une carrière militaire. Le fait a été également souligné par Lockhart lorsqu’à la fin de son propre récit, il s’agit de dresser un bilan de l’existence du barde :
I suspect that at the highest elevation of his literary renown – when princes bowed to his name, and nations thrilled at it – he would have considered losing all that at a change of wind as nothing compared to parting with his place as the Cadet of Harden and Clansman of Buccleuch, who had, no matter by what means, reached such a position, that when a notion arose of embodying « a Buccleuch legion », not a Scott in the Forest would have thought it otherwise than natural for Abbotsford to be one of the field-officers.12
Abbotsford, cette propriété que Scott a achetée grâce à son immense succès et pour laquelle il s’est aussi en partie ruiné en l’étendant et en en faisant une demeure nobiliaire, devient ici par métonymie une manière de désigner l’auteur lui-même. Le sérieux avec lequel il envisage les devoirs qu’il attache à ce statut de propriétaire terrien et au clan explique cette hiérarchie des activités qui place l’épée devant la plume. Même si ce sont ses gains et sa célébrité littéraire qui lui ont permis de renouer fantasmatiquement avec une ascendance noble lointaine, sa famille étant issue d’une branche cadette, ses préjugés rendent compte de la désinvolture avec laquelle il s’exprime quand il parle de sa carrière et de sa formation poétiques. De fait, cette prise de distance constante est loin d’être une pure posture, bien qu’il y ait là quelque chose qui relève de l’ironie du sort, même pour son gendre qui cherche à renforcer la respectabilité de Scott : c’est bien l’infirmité de l’auteur qui, d’un côté, lui a interdit la carrière militaire mais qui, de l’autre, lui a permis in fine de défendre les valeurs de la noblesse d’épée à laquelle, en fait, il ne pouvait prétendre.
Aussi l’accès à la littérature orale et écrite, libérateur à maints égards, est-il le résultat inattendu de cette infirmité : la poésie et le goût pour la fiction deviennent dans ses mémoires le fruit de son éducation décousue. Échappant à la discipline ordinaire à laquelle les enfants et les adolescents de son âge doivent se soumettre (il ne faut pas oublier que les Écossais avaient droit à une éducation de qualité qui ne s’adressait pas aux seules classes privilégiées), Scott accentue les effets du hasard (chance) et les multiplie dans son récit :
In the mean-while my acquaintance with English literature was gradually extending itself. In the interval of my school hours I had always perused with avidity such books of history or poetry or voyages and travels as chance presented to me – not forgetting the usual, or rather ten times the usual quantity of fairy tales, eastern stories, romances, &c. which usually form the first studies of youth. These studies were totally unregulated and undirected. […] Chance, however, threw in my way a poetical preceptor. This was no other than the excellent and benevolent Dr. Blacklock well known at that time as a literary character.13
Les différents maîtres qui ont contribué à l’esprit de l’auteur alternent avec les différentes lectures qu’il a pu faire en dehors du curriculum scolaire et des pratiques familiales : les uns comme les autres sont purement contingents. C’est l’imagination elle-même qui est associée avec le vagabondage mental, avec une certaine absence de contrôle conscient de Scott lui-même sur son esprit et de direction dans ses efforts. Au sein même de ses lectures, il distingue d’un côté les ouvrages d’histoire, de poésie et les récits de voyages qui sont socialement acceptables, de l’autre les contes de fées et orientaux et les romans d’imagination qui le sont beaucoup moins. Cette alternance témoigne du fait que Scott adopte une sorte de double discours, car d’un côté, l’imagination lui est indispensable, elle doit rester en partie libre, parce que c’est ainsi qu’elle fonctionne ; et de l’autre, il considère bien qu’il est nécessaire de contrôler cette faculté si puissante mais potentiellement dangereuse. Les recherches antiquaires, avant la poésie, avant les romans, se présentent comme un moyen de satisfaire ce double aspect de sa personne. Là aussi c’est une nouvelle rencontre littéraire qui lui permet d’actualiser ce qui n’était qu’en germe ; au lecteur de tirer de ces menus faits ce qui a formé le futur poète.
Above all I then first became acquainted with Bishop Percy’s Reliques of Ancient Poetry14. As I had been from infancy devoted to legendary lore of this nature and only reluctantly withdrew my attention from the scarcity of material and the rudeness of those which I possessed, it may be imagined but cannot be described with what delight I saw pieces of the same kind which had amused my childhood and still continued in secret the Delilahs of my imagination considered as the subject of sober research, grave commentary and apt illustration by an editor who shewed his poetical genius was capable of emulating the best qualities of what his pious labour preserved.15
Le vagabondage mental se double d’un vagabondage au travers des Borders. Scott nous apprend que son père récriminait contre ses errances et ses flâneries au gré de ses « digression[s] »16 et le surnommait « colporteur itinérant » (strolling pedlar17). Même si ces déambulations pouvaient ressembler à une revanche sur son infirmité, elles sont associées à une oisiveté coupable et à des activités qui ne correspondent pas à sa classe sociale. Pourtant l’auteur nous fait deviner encore une fois que, malgré l’opprobre, il s’agit d’une expérience tout aussi essentielle à sa formation de poète que ses lectures qui ont été menées sans méthode véritable, et elle le renvoie à la figure des derniers ménestrels (col)porteurs de poésie populaire.
En cela, on peut comprendre pourquoi David Hewitt associe sur un mode mineur ces mémoires avec le Prélude de Wordsworth18, à la fois par l’errance, l’expérience de la nature et par un même esprit qui se forge au gré des rencontres. Même si Scott a fréquenté Wordsworth, on peut parler davantage d’une convergence d’esprit, plutôt que d’une inspiration authentique. Le lecteur est implicitement appelé à se demander comment ces hasards et ces contingences se retrouvent transmutés dans sa création, d’autant que le mémoire de l’Écossais s’arrête avant de parler de ses débuts dans la poésie et qu’il donne comme fin, au double sens de but et de terme, l’entrée du jeune homme dans la vie sociale d’Édimbourg et dans sa vie professionnelle.
Fortune poétique et Fortune sociale : les ambiguïtés de la posture scottienne
Lorsque Scott rend compte de son entreprise poétique en 1830 pour The Lay of the Last Minstrel, et revient sur la période de 1803, il fait apparaître toute l’ambivalence sociale liée à la poésie. Elle l’a freiné dans ses aspirations sociales, mais, sur un autre plan, elle lui a permis de les réaliser. Toutefois, il n’est pas toujours convaincu que cette voie soit aussi honorable que celle que son père lui a proposée :
At this time I stood personally in a different position from that which I occupied when I first dipt [sic] my desperate pen in ink for other purposes than those of my profession. In 1796 when I first published the Translations from Bürger, I was an insulated Individual, with my own wants to provide for, and having, in a great measure, my own inclinations alone to consult. In 1803, when the second volume of the Minstrelsy appeared, I had arrived at a period of life when men, however thoughtless, encounter duties and circumstances which press consideration and plans of life upon the most careless minds. I had been for some time married – was the father of a raising family – and […] it was my duty and desire to place myself in a situation which would enable me to make an honorable provision against the various contingencies of life.
It may be readily supposed that the attempts which I had made in literature had been unfavorable to my success at the Bar. The goddess Themis is at Edinburgh […] of a peculiarly jealous disposition. She will not readily consent to share her authority, and sternly demands of her votaries, not only that real duty be carefully attended to and discharged, but a certain air of business shall be observed even in the midst of total idleness.19
Idleness n’a pas du tout les connotations positives de l’otium des anciens. C’est un vocabulaire que Scott a utilisé dans ses mémoires et qui renvoie à une inaction coupable et vaine ou à une activité qui n’est pas sérieuse. Les préjugés de son père, lui-même homme de loi, rejoignent les préjugés de sa profession auxquels il doit faire face. On voit un portrait en creux se dessiner qui coïncide avec celui que l’auteur des mémoires a pu brosser, celui d’un jeune homme, puis d’un homme naturellement insouciant qui doit se plier à ses devoirs, au barreau d’abord, puis à sa famille. Le devoir est clairement associé à la capacité de répondre aux contingences et donc aux vicissitudes de l’existence. Au moment où Scott rédige sa préface, il sait que les succès financiers que sa réussite poétique lui ont permis d’atteindre ont été illusoires, puisqu’ils ont été emportés par la faillite de Ballantyne et par la crise économique de la fin des années 1820. Il se présente donc comme si, en 1803, il était encore à la croisée des chemins, sommé de choisir entre sa profession et les « Delilahs de son imagination » pour reprendre l’expression de la préface et qui fait directement écho au mémoire qu’il vient de réviser. La préface reprend d’ailleurs d’autres éléments de son autobiographie, comme l’évocation de son infirmité et son rôle dans la formation du poète, mais Scott introduit aussi une troisième image de lui-même, à savoir celui qui a joué un petit rôle militaire et s’est engagé physiquement autant qu’il lui était possible pour mobiliser les troupes civiles en cas d’invasion napoléonienne20.
Ces trois représentations concurrentes de l’Écossais, à savoir le poète, l’homme de loi, et dans une moindre mesure l’homme d’armes, témoignent en fait de ses efforts pour mettre à distance l’auteur qui a gagné considérablement d’argent grâce à la vente de ses livres et des copyrights qu’il a négociés avec avantage auprès de ses éditeurs. Aussi les 300 livres qu’il a reçus comme sheriff ont une importance capitale à ses yeux, surtout dans la période qui suit sa banqueroute.
I adopted at the same time another resolution, on which it may doubtless be remarked, that it was well for me I had it in my power to do so, and that, therefore, it is a line of conduct which, depending upon accident, can be less generally applicable in other cases. Yet I fail not to record this part of my plan, convinced that, though it may not be in every one’s power to adopt exactly the same resolution, he may nevertheless, by his own exertions, in some shape or the other, attain the object on which it was founded, namely, to secure the means of subsistence without relying exclusively on literary talents. In this respect I determined that literature should be my staff, but not my crutch, and that the profits of my literary labor, however convenient otherwise, should not, if I could help it, become necessary to my expenses.21
Certes cette déclaration de conduite préalable sonne étrangement chaque fois que Scott, au cours de ses préfaces poétiques, revient sur ses gains, mais elle traduit à la fois une rhétorique de défense par rapport aux accusations d’imprudence qui ont pu être portées contre lui (un homme qui tient compte des contingences – accident – dans ses choix moraux peut-il être qualifié d’imprudent ?) et sa réticence à être réduit à son seul statut d’auteur. Elle met enfin ses succès insolents à distance, comme s’il avait prévu d’emblée la fragilité de sa réussite et les caprices de la Fortune. Lockhart le suivra dans cette voie car, comme le souligne Barton Swain, il s’agit de mettre en avant, malgré les gains et leur décompte, un amateurisme de bon ton que le gendre de Scott voudrait voir associé avec l’activité littéraire elle-même22. Pour un homme de sa classe sociale, l’acte d’écrire est une sorte de complément à l’activité professionnelle principale, et celle-ci lui assure une forme d’indépendance que l’auteur tout entier consacré à son art ne saurait avoir. Cette représentation est pour le moins paradoxale néanmoins, car Scott a justifié malgré tout, contre Lord Byron, la légitimité de tirer un profit de son art23 et s’il rapporte ses gains, c’est aussi pour répondre à une autre stratégie narrative, celle de contrecarrer les accusations d’imprudence dans les affaires.
Mais cet amateurisme supposé permet de créer un ethos en marge de l’acrimonie proverbiale des hommes de lettres et de peindre l’image d’un homme qui n’a jamais totalement pris au sérieux son art ni son inspiration poétique. La préface de 1830 de The Lay of the Last Minstrel fait état de son aversion pour la seule compagnie des hommes de lettres. Les rencontres fructueuses qu’il a pu faire et les nombreux amis et connaissances qu’il a accueillis d’abord à Ashestiel, puis à Abbotsford, reflètent ce désir de développer une sociabilité très large, au-delà des seuls cercles littéraires. Il montre ainsi dans ses préfaces combien il a su profiter des circonstances et de sa bonne fortune, mais aussi, pour l’ensemble de son œuvre, des informations et des récits qu’il a pu glaner çà et là, dans toutes les couches de la société, comme des histoires qu’on lui a racontées. De ce point de vue, Scott, chantre des traditions poétiques et des légendes, était toutefois conscient des effets du marché et donc du besoin de nouveautés pour satisfaire un public changeant et facilement satisfait. Dans sa biographie, Lockhart rapporte un échange entre le poète Thomas Moore et Walter Scott :
They sallied out for a walk through the plantations, and among other things, the commonness of the poetic talent in these days was alluded to. « Hardly a Magazine is now published », said Moore, « that does not contain verses which some thirty years ago would have made a reputation. » – Scott turned with his look of shrewd humour, as if chuckling over his own success, and said, « Ecod, we are in the luck of it to come before these fellows » ; but he added playfully flourishing his stick as he spoke, « when we have, like Bobadil, taught them to beat us with our own weapons. » – « In complete novelty », says Moore, « he seemed to think, lay the only chance for a man ambitious of high literary reputation in these days. »24
Scott serait donc arrivé sur la scène littéraire au bon moment, c’est à cette circonstance accidentelle qu’il attribue la renommée qu’il a acquise. Pour autant, bien qu’il ait joué avec les attentes de son lectorat, tantôt le satisfaisant, tantôt venant rompre avec une veine qu’il jugeait trop usée afin de s’assurer, autant qu’il était en son pouvoir, du succès, Scott répète donc à qui veut l’entendre qu’il n’était pas dupe de la reconnaissance extraordinaire que ce même public lui a adressée. Heureux de savoir plaire et de savoir distraire son lectorat, et d’avoir su répondre rapidement à la demande du public, il se défend toutefois, au soir de sa vie, d’avoir éprouvé l’orgueil de se croire un auteur de génie :
After considerable delay, « The Lady of the Lake » appeared in May, 1800: and its success was certainly so extraordinary as to induce me for the moment to conclude that I had fixed a nail in the potentially inconsistent wheel of Fortune, whose stability in behalf of an individual who had so boldly coveted her favours for three successive times had not as yet been shaken. […] But, as the celebrated John Wilkes is said to have explained to his Majesty, that he himself, amid his full tide of popularity, was never a Wilkite, so I can with honest truth, exculpate myself from having been at any time a partisan of my own poetry, even when it was in the highest fashion in the Million.25
Cette (fausse ?) modestie affichée par l’auteur, la distance qu’il prend par rapport à sa propre création et par rapport à son propre succès s’appuient ici sur l’image traditionnelle de la roue de la Fortune. Il s’agit d’une mise en garde, pour lui-même, mais aussi pour les autres, contre les vanités de ce monde, lui qui a, dans les faits, souffert du succès moindre de certaines de ses œuvres26. Au regard des critiques contre le type de l’auteur génial au mauvais caractère et en marge des normes sociales, l’auto-dérision de Scott confirme sa volonté de se présenter comme une sorte d’enfant de la fortune, un poète opportuniste qui a su saisir pendant un temps les occasions au vol et surtout comme un homme sociable et plaisant dans les temps heureux, comme dans les périodes plus noires.
Le stoïcisme scottien et l’art de faire contre mauvaise fortune bon cœur
Mais si son opportunisme joue un rôle important dans la distance qu’il dit avoir prise par rapport à la célébrité littéraire et donc dans son autojustification, il a néanmoins une face potentiellement plus sombre contre laquelle Scott et Lockhart ont dû se défendre : la spéculation. Une anecdote du mémoire illustre bien les problèmes moraux que pose l’art de se laisser porter par les événements. Dans la liste des personnages qui acquièrent au cours de l’histoire du texte une fonction de miroir dans le mémoire, le grand-père de Scott est présenté de façon très romanesque, comme un personnage moralement ambivalent. Destiné à la marine, il échoua près de Dundee à son premier voyage d’essai et ne reprit jamais la mer ; fils d’un tory convaincu, il suivit l’intérêt du moment et devint whig. L’élément le plus troublant de ce portrait est une histoire avec un berger, Hogg (probablement un ancêtre du berger écrivain James Hogg que Scott a bien connu et fréquenté) :
He took for his shepherd an old man called Hogg who willingly lent him, out of respect to his family, his whole savings, about £30, to stock the new farm. With this sum which it seems was at the time sufficient for the purpose the master and servant set off to purchase a stock of sheep at Whitsun-Tryste, a fair held on a hill near Wooler in Northumberland. The old shepherd went carefully from drove to drove till he found a hirsel likely to answer their purpose, and then returned to tell his master to come up and conclude the bargain. But what was his surprize to see him galloping a mettled hunter about the race-course and to find he had expended the whole stock in this extraordinary purchase. […] In the course of a few days however, my grandfather who was one of the best horsemen of his time attended John Scott’s of Harden’s hounds on this same horse, and displayed him to such advantage that he sold him for double the original price. The farm was now stocked in earnest and the rest of my grandfather’s career was that of successful industry.27
Scott ne commente pas vraiment la rupture de contrat dont est coupable son ancêtre, si ce n’est qu’il compare son effet sur le berger à la consternation (dismay) de la famille du Vicaire de Wakefield quand le fils, Moses, a été trompé. La vente spéculative du cheval, qui semble avoir été purement opportuniste, permet de réparer la faute, mais suggère une morale assez lâche qui dépend du résultat final et du succès financier de son opération. Est-ce que c’est la position de Scott aussi ? C’est ici que les différents moments de la composition peuvent avoir une incidence sur l’image globale que Scott désire donner de lui-même, et de l’héritage qui a fait de lui ce qu’il est devenu. En 1808, cette anecdote n’a pas les implications qu’elle peut avoir en 1826 et plus encore, après sa mort, dans la biographie de Lockhart. À la lumière de la catastrophe financière de 1826, c’est l’échec ultime de ses propres opérations financières avec Ballantyne qui semble jeter le trouble sur des années de collaborations fructueuses. Sa faiblesse éventuelle, ses erreurs de jugement n’apparaissent-elles pas comme telles que parce qu’il connaît une situation de faillite ? Ou au contraire portait-il aussi une part de responsabilité ? La réaction imprimée des héritiers des Ballantyne après la publication de la biographie28 montre à quel point la question reste sensible et démonte tout l’argumentaire de Lockhart qui visait à disculper l’auteur en chargeant les libraires. Mais à côté d’un certain nombre d’éléments qui ont effectivement noirci la réputation des Ballantynes, Lockhart a développé un autre argumentaire qui, malgré ses erreurs éventuelles, a mis en avant la profonde honorabilité de Scott, insistant sur l’image d’un homme brisé qui a sacrifié sa santé et qui, pour rembourser ses dettes et surtout préserver Abbotsford, a écrit abondamment au point qu’il s’est décrit comme « a writing automaton »29. Tout au plus Lockhart concède-t-il que l’auteur a été la dupe de son imagination30 et de son profond désir d’élévation sociale (Abbotsford faisant de lui un propriétaire terrien dans le style des Lairds écossais qu’il représentait dans ses romans). Le biographe cite les célèbres vers d’Horace dans la Satire II, 731 où l’esclave montre à son maître que celui-ci est l’esclave de ses désirs et de ses ambitions et souligne que le véritable sage est celui qui devient le maître de la Fortune en ne craignant ni la mort, ni la pauvreté, ni les chaînes. Scott est à la fois celui qui a été, pour un temps, un enfant chéri de la Fortune, et par là-même son esclave, et celui qui, par son attitude morale, apprend à s’en faire le maître.
Pour construire cette image empreinte de stoïcisme, Lockhart s’appuie à la fois sur les romans de Scott dans lesquels les jeunes héros doivent faire un apprentissage analogue32, sur son mémoire où, on l’a vu, il souligne combien la fermeté est indispensable, et surtout sur son journal intime qui résonne à l’unisson avec les vers d’Horace :
He says on the 30th of December – « Wrote hard. Last day of an eventful year ; much evil – and some good, but especially the courage to endure what Fortune sends, without becoming a pipe for her fingers. »33
Dans cette entrée qui clôt l’année 1826, Scott recouvre par « eventful year » et par « much evil » le décès de sa femme et sa faillite. Il traduit plus loin ce qui a été traditionnellement compris comme le stoïcisme d’Horace en un sens plus chrétien grâce à une réflexion sur la vanité de l’existence humaine et les prétentions illusoires de l’homme à se voir le sommet de la Création :
O God ! What are we ? – Lords of nature ? – Why a tile drops from a house-top, which an elephant would feel no more than the fall of a sheet of paste-board, and there lies his lordship. Or something of inconceivable minute origin – the pressure of the bone, or the inflammation of a particle of the brain – takes place, and the emblem of deity destroys himself or some one [sic] else. We hold our health and our reason on terms slighter than one would desire, were it in their choice, to hold an Irish cabin.34
L’homme est mortel et, de ce fait, victime potentiel du moindre accident qui peut à tout moment détruire son existence. Citant des vers qu’il attribue à Spenser, Scott, toujours dans son journal (1827), compare l’existence à un songe dont à chaque étape l’homme doit se réveiller, jusqu’à la mort qui n’est peut-être que le réveil ultime35. Mais si ces exercices spirituels lui permettent de reconnaître la vanité des succès et de la réussite, ils ne s’accompagnent pour autant de l’image d’un Scott qui serait parvenu à se détacher totalement des affections de ce monde. Lockhart préfère montrer un homme brisé mais luttant avec vigueur et sincérité contre le désespoir et la maladie (« he struggled manfully, however, against his malady »36) et rompant avec son indulgence coupable passée37.
Les extraits que Lockhart retient suivant le décès de son épouse Charlotte témoignent à la fois de sa peine, de sa réticence à imaginer son épouse pour toujours loin de lui (il confesse des visites nocturnes de sa femme en rêve) et de son sens du devoir38 qui lui commande de ne pas se laisser aller à sa mélancolie face à l’infortune. Ces sentiments mêlés, le souci qu’il éprouve pour la peine de sa fille suffisent à l’exonérer de toute accusation d’insensibilité et d’indifférence, car la fermeté d’âme que l’auteur et le biographe donnent en modèle est une fermeté empreinte de bienveillance et de sympathie.
Dans ce contexte, pour Lockhart, la veine autobiographique de Scott n’est pas seulement une concession faite au public, une spéculation éditoriale parmi d’autres, elle participe activement de cet exercice spirituel car elle est une occasion de voir, enfin, la vérité en face. La qualité de l’autobiographie témoigne de la valeur et de la profondeur de la veine moraliste :
He now took up in earnest two pieces of work, which promised and brought great ultimate advantage ; namely, a complete collection of his Poems, with biographical prefaces ; the other, an uniform edition of his Novels, each to be introduced by an account of the hints on which it has been founded, and illustrated throughout by historical and antiquarian annotations. On this last, commonly mentioned in the Diary as the Magnum Opus, Sir Walter bestowed pains commensurate with the importance ; – and in the execution of the very delicate task which either scheme imposed, he has certainly displayed such a combination of frankness and modesty as entitles him to a high place in the short list of graceful autobiographers. True dignity is always simple ; and perhaps true genius, of the highest class at least, is always humble.39
Même si, pour Lockhart, les introductions des romans dans le Magnum Opus et l’appareil critique s’inspirent davantage des recherches antiquaires que des récits de vie, on n’oubliera pas, comme on l’a montré plus haut, que ces recherches ont aussi un sens moral pour Scott puisqu’elles lui permettent de concilier des aspects presque irréconciliables de personnalité : l’imagination et le sérieux. En ces sens, elles peuvent s’interpréter comme un effort pour encadrer en des termes socialement acceptables une activité romanesque toujours sujette à caution, une fois que son anonymat avait été levé ; et surtout, par le travail qu’il y a mis, de manifester son respect pour ses lecteurs. Enfin le journal, dont Lockhart n’a publié que quelques extraits, fait coïncider l’homme et l’écrivain en témoignant à la fois des qualités d’écriture et de la valeur morale de celui qui s’est observé derrière son bureau au soir de sa vie, dans la peine et la maladie.
Le hasard et la Fortune jouent un grand rôle dans la veine autobiographique scottienne : ce sont à la fois des occasions dont il faut se saisir pour se construire et réussir, et une clé qui est apportée aux incidents de ses romans et qui est implicitement offerte au public. Ils sont un ferment de son imagination et de son ambition, ainsi qu’une illusion dont, au soir de sa vie, il a dû se détacher. Il en résulte un curieux mélange de légèreté, de désinvolture même et de profondeur morale. Même si Scott ne semble pas dans ses mémoires pousser très loin l’introspection, préférant sans doute que le lecteur tire les conclusions, leur stratification et son effort pour y revenir à différents moments de sa vie, les jeux de miroirs qui se créent, de ce fait, non seulement entre les figures secondaires de ces mémoires et lui-même, mais aussi entre les différents textes à valeur autobiographique qu’il produit à partir de 1826, suggèrent un plus grand travail d’approfondissement qu’on ne lui reconnaît d’ordinaire. Lockhart est à la fois celui qui a permis de mettre au jour ce travail, et celui qui s’en est servi à des fins apologétiques pour défendre la mémoire de l’auteur. Toutefois, les dernières pages de la biographie apportent un dernier éclairage sur les illusions sociales de Scott : malgré ses efforts, le titre qu’il voulait tant transmettre à ses fils a été perdu car ses héritiers mâles, comme le reste de ses enfants, sont morts prématurément, sous le coup d’un dernier revers de la Fortune. C’est donc son gendre qui s’impose de façon ultime comme le légataire spirituel de Scott et le gardien de sa mémoire.