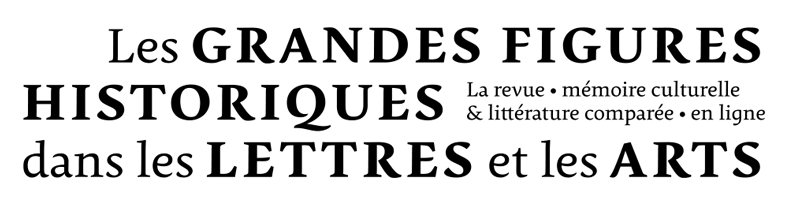Dans un de ses derniers livres en date, intitulé La vie n’est pas une biographie (2019), Pascal Quignard invalide la narration du vécu au prétexte qu’aucune entreprise de ce type ne saurait accéder à l’intériorité infantile la plus reculée, qui est une période de traumatismes sans langage pour les verbaliser, et que ce récit reste très en-deçà de l’existence psychique, dont le fonctionnement associatif n’est pas réductible à une chaîne rationnelle de causalité. Par-là, il s’inscrit à la traverse de la vogue biographique actuelle. Concernant la relation des parcours artistiques, la critique de Quignard est d’autant plus recevable que la création mobilise les ressorts les mieux enfouis de la personnalité et transcende les circonstances journalières ou exceptionnelles. Tout informés qu’ils sont des conditions de l’inventivité par leur propre pratique, nombre d’écrivains s’essaient pourtant au genre de la biographie artistique depuis le XXe siècle, fût-ce de façon latérale ou fragmentaire. Pour preuve, la production littéraire relative à Pablo Picasso cède volontiers à « l’illusion biographique » dont parlait Pierre Bourdieu1, surtout après-guerre, à l’heure de son universelle consécration. À lire ce corpus2, on est surpris non tant de l’indifférence des auteurs à l’égard des complications de la psyché – Norman Mailer, par exemple, y fait droit – que de leur difficulté à appréhender les aléas d’un itinéraire de longue haleine, très heurté sur le plan existentiel comme esthétique. Or, l’évolution de Picasso ne répond pas à une logique de la cohérence et de l’orientation ; elle érige l’expérience et le hasard en moteurs du changement. À Françoise Gilot, il déclare ainsi : « Je peins comme d’autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles, finies ou non, sont les pages de mon journal, et en tant que telles, elles sont valables. »3 Son œuvre se veut donc en prise directe avec le fortuit et le présentisme, non avec le passé et la rétrospection (d’où l’impropriété du terme « autobiographie » qu’emploie Picasso pour décrire son processus d’expression). Selon ses propres mots, Picasso est « comme le fleuve qui continue à couler, roulant avec lui les arbres déracinés par le courant, les chiens crevés, les déchets de toute sorte et les miasmes qui y prolifèrent », tant il se dit porté par « le mouvement de la peinture », à savoir « le mouvement de [sa] pensée »4 en expansion continue et changeante. La prise en charge littéraire de ce choix de l’immédiat et de l’accidentel se révèle très relative sous la plume des écrivains, lesquels s’abstraient difficilement, on le verra, des représentations topiques de l’artiste comme des modes vectorisés de l’expression linguistique. Somme toute, leurs écrits sur l’aventure de Picasso mettent en évidence la cristallisation de l’identité plus que la survenue de l’aléatoire. Ils substituent une phénoménologie du sujet à la pragmatique du casuel.
La vocation continuée
Sous cette formule à rebours du titre de Pierre Klossowski, on entend montrer que le mythe de la vocation artistique, en se perpétuant au-delà du romantisme jusqu’à l’orée du modernisme, conditionne les figurations littéraires de Picasso. Il se fait à ce point prégnant qu’il n’y laisse guère d’espace à la manifestation de l’imprévisible. D’ailleurs, il est très rare que l’évocation de Picasso s’en tienne à la pure factualité. Le relevé des faits, avec son bagage d’anecdotes, forme le matériau de l’Autobiographie d’Alice Toklas (1934) : la présence de Picasso y est fonction des circonstances de l’activité parisienne du champ artistique. Son auteur, Gertrude Stein, qui adopte la voix et le vécu de sa compagne, ne problématise pas le donné. L’arasement de l’existence au niveau de la chronique ne permet pas d’insister sur les caprices du hasard, tout au plus d’indiquer rencontres et péripéties. Quoi qu’il en soit, ce livre tient de l’exception dans notre bibliographie. Le restant est largement empreint de la « conception vocationnelle de l’art »5, qui refonde une forme de déterminisme, celui-là individuel, contraire à l’emprise du principe d’incertitude sur le déroulement d’une vie. Les évocations biographiques de Picasso se ressentent généralement de cette vision de l’artiste élu, destiné à faire fructifier les biens esthétiques de la création au mépris des valeurs mercantiles du capitalisme, selon les voies d’un désintéressement dont les « bénéfices symboliques »6 sont différés sous les espèces du renom et de la gloire.
Une telle construction culturelle de la figure artistique passe par un ensemble d’épisodes significatifs, au fort pouvoir mythifiant, qui actualisent, à l’ère démocratique et méritocratique, la tradition des anecdotes légendaires née dans l’Antiquité avec Duris de Samos et perpétuée notamment, à la Renaissance, par Vasari dans Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Dans le cas de Picasso, c’est la scène où le père, peintre de son état et professeur de dessin à La Corogne, fait don de ses pinceaux à son jeune fils, qui prend une coloration fabuleuse parce qu’elle vaudrait pour une abdication consécutive à la reconnaissance de la supériorité artistique du rejeton sur son géniteur7. Jaime Sabartés propage le récit dans Picasso. Portraits et souvenirs (1946). L’anecdote fait florès dans l’historiographie du peintre et touche l’imagination des écrivains, par exemple celle de René Char dans sa préface au catalogue de l’exposition d’Avignon en 1973. « Son père, artiste honorable, devant les dessins de l’adolescent, avait baissé les bras et pris congé de son ouvrage », rappelle le poète au souvenir de l’historiette, avant d’ajouter en référence au tableau Le Jeune Peintre (1972) qu’il considère comme un autoportrait différé : « un père prévoyant vient de le sacrer roi »8. La scène reconduit en filigrane, dans le domaine pictural, le modèle du jeune Mozart, instruit par un père qu’il finit par dépasser. Elle convertit la famille en premier cercle de consécration. Elle change la passation du pouvoir créateur en transfert de responsabilité entre le père et le fils. Elle s’élève à la hauteur d’un rite initiatique qui investit l’enfant Picasso d’un charisme de haut vol, mais aussi d’une éthique du travail artistique, fondée sur l’ascèse, qui prohibe les égarements et autres écarts de la ligne de conduite. S’il est vrai que la réussite rapide du Malaguène ne permettra guère aux écrivains de décrire la voie des sacrifices dévolue aux créateurs d’envergure depuis le mythe de l’artiste maudit – on compte Max Jacob parmi les exceptions pour la période de l’âge héroïque9 –, elle aura toujours pour corollaire l’investissement exclusif dans l’activité picturale. Il n’est auteur qui ne tienne pour accomplie la vocation de Picasso, à toutes les étapes de son cheminement.
Au-delà des circonstances, auréolées de commentaires hagiographiques, bien des écrivains exploitent le nom du peintre pour servir la lecture déterministe de sa trajectoire. Deux éléments favorisent la surinterprétation « vocationnelle » de l’onomastique. En premier lieu, le choix du matronyme Picasso au détriment du patronyme Ruiz s’apparente à l’effet d’un pseudonyme (surtout pour des Français, habitués à l’éviction du nom maternel dans leur état-civil) car, étant le fruit d’une intention, il est le témoignage d’une élaboration précoce de soi dont les faits postérieurs vérifieront le caractère programmatique. En second lieu, le statut d’authentification que revêt la signature dans les arts visuels incline à majorer le signifiant « Picasso » jusqu’à en motiver les composants phoniques. Sabartés, de par ses origines, se garde de toute herméneutique de l’appellation artistique, et l’envisage sous le rapport de la commodité : « D’abord [Picasso] signa ses œuvres du premier nom paternel et du premier nom maternel, suivant l’usage espagnol ; mais le nom de Ruiz étant des plus répandus, nous, Catalans, l’appelons Picasso. À la longue, c’est le nom qui lui resta, surtout parce que sa prononciation est plus facile pour un Français. »10 Il en va tout autrement pour Francis Ponge. En commençant son « Texte sur Picasso » (1974) par l’écriture du nom, le poète donne à jouer à son imaginaire de l’invention combative. L’attestation scripturale « Picasso » à l’attaque de sa prose donne lieu à une décomposition en syllabes ou en lettres qui vise à y déceler le sens d’une existence vouée à la refonte des formes. L’oreille française de Ponge entend l’esprit de conquête de l’artiste dans le calembour pique/assaut. Le graphème « P » serait l’« étendard » de la victoire de Picasso sur le monde et il se verrait « magiquement tricoloré11 » par les trois phonèmes i, a, o, associées aux révolutions contre les conservatismes esthétiques et sociaux suivant l’héritage rimbaldien du sonnet « Voyelles ». Espagnol, Rafael Alberti s’interdit la glose sur un nom dont la prononciation serait francisée. Il n’en consacre pas moins tout un recueil, intitulé Les 8 Prénoms de Picasso (1970), à supposer un lien de dépendance entre les noms de baptême de l’artiste et ses possibilités de création :
Comment aurait peint Diego Picasso
comment José Picasso,
comment Francisco de Paula Picasso,
comment Juan Nepomuceno Picasso,
comment María de los Remedios Picasso,
comment Crispín Picasso,
comment Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso ?12
Son nom, couplé à un prénom dont il partage l’initiale et la finale, assigne à Picasso une identité qui est moins sociale (rivée à une filiation) qu’artistique parce qu’elle résulte d’une auto-désignation rénovatrice du moi. Aux yeux des écrivains susnommés (mais encore pour Michel Leiris ou, de façon humoristique, pour Roger Vitrac13), ce nom est certes une marque de certification, mais surtout un indice de prédestination, auquel s’attache une personnalité (sinon une lignée) et dont les connotations ratifient le parcours du peintre, vu comme un destin inscrit dans les signes.
Heureux hasards
Certaines entreprises biographiques touchant Picasso n’empruntent pas la pente du déterminisme de la vocation et du nom, ou alors avec distance. Dans Les Ateliers de Picasso (2003), Michel Butor élabore un texte à triple niveau énonciatif, décliné en douze époques qu’illustrent des photographies de l’artiste, de ses œuvres et de ses lieux d’activité. Repérables au style des caractères et à la nature de la justification, trois locuteurs successifs se prononcent à chaque fois sur l’évolution du peintre : Lola (la sœur de Picasso), puis « Pablo-Minotaure, Thésée » (l’artiste en personne), enfin le narrateur sous couvert de la didascalie « 39 instantanés de la vie d’Arlequin ». Chaque moment évoqué fait l’objet d’interprétations bien différenciées, mythologique pour la première, factuelle pour la deuxième, ironique pour la dernière, en sorte que la biographie en mots et en images que propose ce livre neutralise l’univocité exégétique, ramifie les possibilités explicatives, hypothèque la transfiguration des faits tout comme leur réduction à un concours de circonstances. L’anecdote de la passation des pouvoirs picturaux entre le père et le fils est ainsi mise dans la bouche de Lola sans autre confirmation discursive : « Notre père nous avait dit adieu au cours d’une cérémonie touchante, et satisfait des premières figures qu’il avait peintes dans les linéaments de son palais futur, il lui avait fait don de ses propres pinceaux. »14 Dans Portrait de Picasso en jeune homme (1995), Norman Mailer, quant à lui, se montre autrement plus dubitatif à ce propos. En amorce de son essai de désacralisation, il écrit cette phrase : « À mesure que se développait la légende de Picasso, quelque quarante ou cinquante ans plus tard, souvent avec l’aide de Sabartés, on nous demanda de croire que don José avait abandonné la peinture et fait don de ses pinceaux à son fils, dont le talent augurait d’être plus exceptionnel. »15
Il est même un cas qui entend démontrer par l’absurde et par l’imposture l’inanité du récit de vie, de ses conventions comme de ses présupposés. Il s’agit de Jusep Torres Campalans, canular biographique de Max Aub publié au Mexique en 1958, puis en traduction française en 1961 avec la complicité d’André Malraux. L’ouvrage se donne pour la réhabilitation d’un grand artiste catalan, très proche de Picasso, qui, tel un Rimbaud de la peinture, aurait abandonné la création afin de fuir dans le Chiapas, inconscient de son génie et victime de son insuccès. Il adopte toutes les apparences de la monographie scientifique (chronologie, biographie, édition de documents, transcription d’entretiens, le tout annoté en détail, enfin catalogues d’exposition). Mais il joue en sous-roche d’une ironie mordante. L’iconographie reproduite, d’une totale nullité, désavoue visuellement les éloges du texte, lequel use de la vie de Picasso comme d’un contre-modèle pour mieux suggérer la mystification et, au-delà, le ridicule de la déification des artistes. Dans son récit, Aub moque notamment la spéculation intellectuelle. Paysan mal dégrossi, Campalans aurait été « employé, pour sa bonne écriture, chez un notaire de la ville » sans « rien comprendre à ce qu’il copiait », ce qui entraîne le commentateur à voir dans l’usage purement esthétique de la calligraphie « son goût pour la peinture » et « sa conception formelle de l’art, de sa foi dans le signe »16. L’herméneutique procède alors par raccourcis risibles. En vérité, Aub met sa force de conviction à défendre un peintre qui n’a aucune vocation à la peinture et n’offre aucune finalité à son existence. Ce sont les hasards des rencontres, par exemple celle de Picasso, qui déterminent son itinéraire. Campalans est le jouet de circonstances qui le conduisent par accident à côtoyer les artisans de la révolution esthétique du siècle dernier. « À ses yeux, écrit Aub de Campalans, une chose n’avait rien à voir avec l’autre. »17 Et son existence en témoigne qui est dépouillée de prédestination et même d’intention, à rebours des vies de créateurs, comme celle de Picasso sous-jacente à la sienne. En définitive, si ce livre démonte les rouages de la biographie d’artiste, il n’en annule pas totalement la validité démonstrative puisqu’en recourant au contre-exemple de Picasso, il ne démonétise pas totalement la valeur prédictive de la vocation.
Dans le volet documentaire de l’ouvrage, Aub reproduit les prétendues pages du journal intime de Campalans comme une preuve en acte de son inconsistance. Le même procédé sert à une fin inverse dans « Picasso, chemin faisant », suite chronologique de réflexions et d’anecdotes initialement publiée par Claude Roy dans l’album La Guerre et la Paix en 1954, dans L’Amour de la peinture l’année suivante. Certes, l’enchaînement des dates favorise la disparate et l’éclatement des propos ; il épouse au plus près la succession des moments vécus et pourrait prêter à la démonstration du règne de la contingence. À la vérité, Roy se fait diariste à l’imitation de Picasso qui, explique-t-il, « dessine et peint comme on tient son journal » au point de « dat[er] et [de] numérot[er] ses notes comme les témoignages de l’intime succession de son esprit, comme des jalons de lui-même »18. Cette modélisation artistique de l’écriture au jour le jour ne plaide pas, contre toute attente, pour l’expression d’un aléatoire sans mélange, mais pour la recherche d’une ressaisie de l’impondérable. Roy exprime ainsi sa profession de foi dans le besoin d’une correction humaine, délibérée et inventive, des jeux de l’imprévu : « L’animal et la plante acceptent l’arbitraire des événements, se plient aux lois du milieu. L’homme est cet animal qui ne prend pas les choses comme elles sont. L’art (et l’industrie) commencent là. »19 Puis Roy de décrire « l’atelier provençal de Picasso »20. La Chèvre (1950), sculpture faite de bric et de broc, de restes tombés sous la main, y incarne aux yeux de l’écrivain « la volonté de transformer le hasard en nécessité »21, volonté propre à l’homme et, de façon exemplaire, à Picasso. Roy ébauche ainsi, et tout à la fois éprouve dans son option rédactionnelle, une conception anthropologique du rapport non religieux à la fortune, bonne ou mauvaise. Son écriture, suspendue aux aléas de la vie courante, mais portée à en dégager les possibilités épiphaniques, entend à l’instar de l’œuvre de Picasso devenir le miroir de la lutte des modernes contre l’absence de finalité de notre présence au monde, après le déclin des croyances en la fatalité et en la providence.
À l’heure de tirer le bilan du parcours de Picasso dans La Tête d’obsidienne (1974), Malraux persiste à considérer l’art comme cet « anti-destin »22 dont il élaborait la notion dans Les Voix du silence en 1951 : la création est l’instrument d’une désaliénation de notre condition mortelle. Picasso fournit à Malraux (comme à Roy) le meilleur exemple contemporain d’une existence rebelle à la capitulation devant la finitude. La direction esthétique de cette vie d’artiste répond à l’angoisse du néant avec la vigueur d’un « pouvoir démiurgique »23 sans repos ni faiblesse. La perspective de sa disparition à plus ou moins longue échéance constitua pour Picasso le stimulant de son esprit inventif ; elle l’incita à doter de substance imaginative le fil des jours. Cette énergie industrieuse consiste à tirer un parti artistique des surprises que procure le quotidien – parfois les événements, mais surtout les rencontres et les objets. « La vie le surprenait »24, déclare Malraux, avant de décrire Picasso en promenade, « arrach[ant] une branche ou ramass[ant] un caillou »25 dans l’idée de les employer à signifier plastiquement. L’insistance mise par l’écrivain à décrire les sculptures – par exemple Le Faucheur – est révélatrice de sa fascination pour une production qui plie à la logique de la créativité personnelle les réalités apparues par raccroc. Cette capacité à changer la finalité des choses surclasserait chez Picasso le vertige mortifère, à en croire Malraux : « Picasso fut habité par la métamorphose plus profondément que par la mort. »26 Une forme de jubilation née de la coïncidence inopinée avec les matériaux du monde, qu’ils soient naturels ou artificiels, domine dans l’acte créateur de Picasso, y compris lorsque ce dernier se trouve confronté à l’héritage culturel des maîtres et des civilisations : il prouve alors, selon Malraux, que le Musée imaginaire est un ferment d’inspirations, un principe métamorphique qui oppose à la mort la dynamique du vivant. En tout état de cause, l’ouvrage de Malraux, comme le texte de Roy avec le journal intime, prêche d’exemple pour mettre en conformité sa conception avec sa démonstration. Il prend d’abord pour origine un simple coup de téléphone de Jacqueline, la veuve de Picasso27, qui invite l’écrivain à lui rendre visite, ce qui fait de La Tête d’obsidienne un livre de circonstance. Il adopte aussi volontiers la forme du dialogue – avec Jacqueline, mais aussi avec l’artiste et les visiteurs de son exposition en Avignon – parce qu’il s’agit de préserver la sensation du spontané comme l’étonnement de l’inattendu. Avec ses moyens littéraires, qui lui confèrent un pouvoir relatif de composition sur les événements, Malraux tend lui aussi à s’approprier l’univers des contingences pour protester de son désir de sens face à l’impondérable.
L’inflexion identitaire
Lors de son travail d’approche de Picasso, Malraux refuse d’entrer dans des considérations biographiques qui l’éloigneraient de sa visée ontologique. Tout autre est le projet de Mailer, qui entend raconter les débuts du peintre. Si l’écrivain américain se délivre à cet effet des légendes colportées sur l’artiste, il ne donne pas de son existence une lecture strictement factuelle. D’ailleurs, il ne dissimule pas la maigreur de ses apports documentaires. D’après la préface, son but n’est pas de proposer « une étude savante originale », mais d’utiliser ses sources livresques, dûment filtrées, à la réalisation d’« une biographie interprétative »28. Sa démarche est d’obédience psychanalytique, non qu’elle dresse un diagnostic clinique du psychisme de Picasso, mais parce qu’elle identifie certains faits comme des facteurs névrotiques. Mailer finit ainsi par faire peser sur Picasso une fatalité psychologique, à l’enracinement infantile, qui ne laisse guère de place au hasard. S’il est vrai qu’il se détourne des figurations topiques du peintre prodige, il recourt à un système de représentation plus récent, inspiré des théories freudiennes, qui a l’ambition d’expliciter une personnalité d’exception, quitte à l’enfermer dans un déterminisme traumatique sans issue. La référence à Joyce que comporte l’intitulé Portrait de Picasso en jeune homme annonce à juste titre le thème de la vocation artistique, mais le comprend sans le truchement du romanesque et avec l’appui herméneutique de la psychocritique. C’est ainsi que Mailer relève deux événements, datés de l’année 1884, à trois jours de distance : le tremblement de terre de Málaga et la naissance de Lola, sœur rivale de l’enfant roi. Ces bouleversements, dotés d’une « même force [d]istincte de tout ce qui était quotidien et prévisible dans la vie »29, auraient, selon Mailer, provoqué une angoisse de fond, rendu Picasso vulnérable au catastrophisme et disposé à la peinture. L’auteur voit en effet dans l’événement tellurique la racine du pessimisme historique qu’il prête à Picasso : « Depuis l’âge de trois ans (le tremblement de terre de Málaga), Picasso avait une vision catastrophique de l’histoire. »30 Et parce que la famille trouva alors refuge chez le peintre à succès Muñoz Degrain, l’enfant conçut la peinture, croit savoir Mailer, comme une protection apte à neutraliser tout type de cataclysme, réel ou symbolique.
La biographie de Mailer livre une étude comportementale qui suppose à Picasso l’existence de traumas de pure hypothèse. Sa propension téléologique n’est pas non plus exempte d’infléchissement subjectif. On sait Mailer enclin à démystifier le machisme comme dans Les vrais durs ne dansent pas (1984). On pourrait lui en supposer le désir face au virilisme attribué à Picasso, tant il s’attache à l’infirmer en analysant certains épisodes de son existence. Que Picasso ait eu une liaison avec Germaine, celle qui causa le suicide de son ami Casagemas, lui apparaît comme une manifestation d’homosexualité latente : « Quel qu’en fût le coût émotionnel, il lui fallait obtenir la connaissance charnelle de la veuve de Casagemas. De même qu’il copiait les autres peintres […] pour s’immiscer dans leur esprit, de même il absorba la perte de son ami en recherchant la présence de Casagemas dans le corps de la femme que ce dernier avait voulu épouser. »31 Cette sexualité refoulée expliquerait, d’après Mailer, la discrétion des organes génitaux dans les représentations masculines des périodes bleue et rose, ou l’apparition de « femmes aux membres puissants »32 à compter de La Belle Hollandaise (1905). En tout cas, cette interprétation axiologique de Mailer pourrait bien trahir sa propre inclination vers la féminité. Sa biographie est, au vrai, une évocation élogieuse de Fernande Olivier, la compagne de Picasso des années décisives (1905-1912). Il en cite avec abondance l’ouvrage publié en 1933 sous le titre Picasso et ses amis, et mêle parfois sa voix à la sienne. Apocryphes, les Mémoires imaginaires de Marilyn Monroe lui avaient déjà permis en 1982 de s’identifier à une femme confrontée à un créateur d’envergure, en l’occurrence Arthur Miller.
De fait, l’identité du biographe interfère volontiers avec la narration du vécu de l’artiste. Elle lui procure un levier de direction qui en détourne parfois la ligne. Sabartés en apporte l’illustration, car son livre organise le récit biographique autour des portraits de sa personne exécutés par Picasso. Cette iconographie occasionnelle devient le principal mode de régulation de l’histoire. Dans l’ouvrage en question, deux vies se croisent et se précisent, l’une par le texte et l’autre par l’image. Sabartés s’en explique d’emblée : « chaque fois que j’ai vécu aux côtés de Picasso, le hasard a voulu qu’il fasse mon portrait ; je me résous donc à prendre ces portraits pour prétextes. »33 Il y a là une captation du conjoncturel, subjectivement polarisée, qui vise à donner une conduite au déroulement historiographique, sans cela désordonné. Reste que derrière ce dispositif d’agencement, la personnalité du biographe trouve à se questionner. Tels sont les mots de Sabartés contemplant sa physionomie morose dans Le Bock (1901) : « Avide de scruter la toile de mes yeux de myope, je la saisis des deux mains et la lève doucement pour l’examiner sous tous les angles. […] il semble que je cherche à clarifier son contenu, que je lève quelque calice plein du secret de ma plus intime vérité. »34 La quête identitaire de Sabartés, avec son lot de troubles et d’interrogations, a un effet paradoxal sur le rappel du parcours picassien : elle est un facteur de liant narratif qui apporte à la discontinuité des époques artistiques un fort ancrage thématique (le visage du modèle), mais elle ménage dans le suivi des annales des phases dissolvantes, détournées du sujet Picasso et vouées aux confessions d’un narrateur en mal d’exister.
C’est justement le problème de la vocation, littéraire celle-là, qui travaille souvent les évocations biographiques de Picasso. À l’attaque de son livre, Sabartés avoue l’avoir écrit sur la recommandation de l’artiste, qui lui conseilla « la thérapeutique du travail »35 à son exemple pour échapper au malaise existentiel. Dans ses nombreux textes sur Picasso, qui suivent l’évolution esthétique du peintre depuis 1930 et se signalent par leur variété générique, Leiris ne se détache pas non plus de sa propre individualité. De façon déclarée ou pas, il regarde Picasso comme un modèle artistique, voire comme un père en écriture. Les conditions de leur rencontre président à cet étalonnage du parcours personnel. Écrivain en herbe, il croise, en 1926, Picasso dans la rue peu après leur rencontre impromptue à la galerie Simon, dirigée par son beau-père, Daniel-Henry Kahnweiler. À la question de Picasso (« Alors, vous travaillez ? »), Leiris répond par l’affirmative, « en rougissant fortement »36 de la honte d’être indigne d’une pareille marque de considération. Il conclut alors : « ma vie se sera passée, pour une large part, à essayer de justifier l’intérêt qu’il m’avait si gentiment témoigné en demandant des nouvelles de son travail à l’apprenti dont le nom lui avait été dit une fois. »37 Dès lors, les écrits de Leiris sur Picasso sondent toujours en creux le mystère de la vocation, de son maintien tout au long d’une existence, parce qu’ils reportent souterrainement le questionnement sur l’écrivain lui-même, poussé dans ses derniers retranchements identitaires par la figure d’un créateur en constant renouvellement. De façon moins inquiète, mais tout aussi prononcée, Ramón Gómez de la Serna, dans la biographie diversiforme intitulée « Picassismo »38 qu’il intègre à son recueil Ismos en 1931, a beau présenter le peintre sous l’angle esthétique à la faveur d’une succession d’exposés de nature artistique sur sa vie, le cubisme, l’actualité et l’histoire, il s’autorise à parler en témoin et à relater sa rencontre parisienne avec son compatriote en 1916. À ce moment-là, son imagination poétique et humoristique prend le dessus et suggère une intense convergence de vue avec Picasso. Le lecteur comprend alors l’intention secrète du texte : le polygraphe espagnol tend à se reconnaître dans le Protée de la peinture et, parlant de l’itinéraire accidenté et changeant du Malaguène, il se place lui-même face à ses contradictions intimes entre variété et permanence du moi.
*
Hasard ou fatalité ? La vie d’un artiste tel que Picasso peine à se soustraire aux conceptions déterministes. Certes, il n’y a plus lieu d’invoquer la transcendance pour lui supposer un destin depuis que l’inspiration s’est largement laïcisée au sortir du romantisme. Mais la décision inventive qui caractérise ce peintre au puissant charisme, fût-elle aux prises avec les aléas des péripéties personnelles et des événements historiques, s’accommode mal d’une conception phénoménologique du fortuit. D’ailleurs, les interprétations de son existence n’apparaissent pas totalement affranchies des codes de la représentation artistique, qu’elles fassent un sort au topos de la vocation ou à la prédestination du nom. Si d’aucuns, comme Roy et Malraux, accordent à l’imprévisibilité du présent une résidence dans leurs textes, ils soulignent la capacité de Picasso à convertir la contingence en trouvaille plastique et en nécessité personnelle. Au surplus, l’origine littéraire de notre corpus biographique, avec sa part d’expression auctoriale, donne une inflexion supplémentaire à la simple restitution des faits survenus : l’individualité de l’écrivain, qui interprète son sujet à la lumière de ses propres interrogations. Dans ces conditions, le hasard apparaît moins comme un accident sans but que comme une circonstance éligible à la finalité pour peu qu’il soit perçu comme signifiant. Du reste, Henri Bergson le définissait de la sorte dans Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932) : « […] le hasard est donc le mécanisme se comportant comme s’il avait une intention. »39 Face à Picasso, nos auteurs accroissent cette intentionnalité allouée au hasard, dont ils orientent dans un dessein privé (mythe de la création et invention de soi) la tournure aussi imprévue qu’insaisissable.